 Jours de gloire
Jours de gloire
Le site consacré aux jeux d'histoire et aux publications de Frédéric Bey
Notes de lecture
La guerre de Cent Ans, d'Amable Sablon du Corail

« Qui en a le profit, en a l'honneur », cette maxime de Jean de Bueil qui reconnait la primauté de la victoire sur l'honneur chevaleresque sert en quelque sorte d'introduction à l'ouvrage « La guerre de Cent Ans, apprendre à vaincre », d'Amable Sablon du Corail. Dans ce livre remarquable, le conflit entre Valois et Plantagenêt est analysé et caractérisé comme une guerre de souveraineté (sur la Guyenne), bien plus que comme une guerre de succession.
Le récit des événements est passionnant et particulièrement claire. Ecrit dans une langue parfaite, un style rigoureux, savoureux et agrémenté d'un sens de la formule, l'ouvrage développe une thèse de fond novatrice. La volonté des Valois, notamment celle de Charles V, est mise en avant : vouloir , c'est pouvoir. l'auteur décrit la « sobriété et l'hypocrisie » de la communication des rois de France, élément capital dans la mise en oeuvre de leur projet politique. Enfin et surtout, c'est l'importance d'une fiscalité renforcée, pour permettre de payer la rançon de Jean le Bon, qui s'impose comme un des piliers de l'identité française. Son objet : financer la guerre, elle-même matrice de l'Etat moderne. C'est encore l'impôt, réparti sur tout le royaume, qui permet la naissance de l'armée permanente, véritable révolution à mettre au crédit de Charles VII. les exigences fiscales du roi finissent, après 1450, par déboucher sur la confiscation définitive du droit ancestral de consentir à l'impôt.
L'auteur démontre également, qu'à l'opposé de la bourgeoisie des villes, finalement « domestiquée » par les Valois, la noblesse, dont la vocation militaire demeure inentamée, a scellé un véritable pacte avec les Valois. la victoire de ces derniers est aussi la sienne. Il évoque ainsi ceux qui restent quand tout s'effondre : « de ce groupe aux contours incertains et mouvants émergent une quarantaine ou une cinquantaine de noms : ces capitaines et leurs hommes, à peine quelques milliers en tout, ont tenir à bout de bras le royaume de Bourges (...) Les sources d'archives sont rares à sortir cette poignée d'hommes des ténèbres, en raison justement de l'incapacité de Charles VII à contrôler ses gens de guerre, à les passer en revue et à les payer ».
Guerre sans fin, dont les derniers rebonds sont évoquées dans la conclusion de l'ouvrage, la guerre de Cent Ans se solde finalement par une révolution politique qui prime sur les succès militaires initiaux des Anglais qui accaparent habituellement l'attention des historiens. « Labor improbus omnia vincit (un travail acharné vient à bout de tout) », fût-ce en centa ans, c'ets la leçon que nous délivre l'étude magistrale d'Amable Sablon du Corail.
F.B.
Amable Sablon du Corail, La guerre de Cent Ans, Passés Composés, 462 pages
La guerre Succession d'Espagne, de Clément Oury

La monographie de Clément Oury remplit un grand vide : celui des ouvrages en français consacrés à ce tournant de l'histoire européenne. Disons le d'emblée, le livre est remarquable, tant par sa construction qui alterne récit des événements et analyses que par la clarté et la pertinence de son contenu. Permettre au lecteur de comprendre la teneur et la portée d'une si longue guerre n'est pas chose aisée, mais l'auteur y parvient en proposant une histoire (enfin) équilibrée des opérations militaires de 1701 à 1715. les qualités de Marlborough et du prince Eugène, notamment leur aptitude à la prise des risques nécessaires pour obtenir les succès rapides et marquants dont la Grande Alliance a besoin, sont exposées avec mesure, tout comme la résilience exceptionnelle de Louis XIV et de ses armées face au péril inédit que les deux chefs militaires précédemment cités forment avec le grand-pensionnaire Heinsius.
Les mécanismes d'une « guerre limitée » (24 grandes batailles, 108 sièges) - même sis certains pensent sans doute à tort qu'elle ne l'est plus tout à fait - sont développés en profondeur. Le récit du conflit, au cours duquel il faut à la fois « sauver l'honneur de la compagnie » en respectant des codes de l'honneur strictement aristocratiques mais aussi envisager la dévastation systématique de la Bavière ou élaborer des stratagèmes pour emporter la décision, y prend une dimension très concrète, trop souvent négligée. La question omniprésente du ravitaillement et du financement des armées est traitée à sa juste place. Les chapitres sur les vices du commandement français ou sur les racines militaires de la défaite sont particulièrement intéressants et permettent de prendre le recul nécessaire vis à vis des désastres français de 1704 à 1708 et du retournement qui s'ensuit. les pages consacrées à la diffusion de l'information sont toutes aussi pertinentes.
A la hauteur du livre de Jonathan Dull sur le guerre de Sept-Ans, l'ouvrage de Clément Oury donne utilement toutes ses lettres de noblesse à l'histoire militaire sans l'isoler d'un contexte et de préoccupations beaucoup plus larges. Une belle réussite en 500 pages qui offre un point de vue parfois bien différent des très nombreux livres anglo-saxons à la seule gloire de Marlborough.
F.B.
Clément Oury, La guerre de Succession d'Espagne, Tallandier, 519 pages
L'énigme grecque, de Josiah Ober
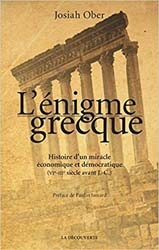
Dans la masse des livres qui sortent chaque année, il devient rare de trouver une thèse ou une approche vraiment originale et constructive, écrite autrement que pour casser un mythe de plus ou prendre le contre-pied obligé de tout ce qui a déjà pu être dit. Entre analyse géographique et chiffrée d'un inventaire des 1100 cités-états grecques indépendantes et tentative d'explication de l'efflorescence (croissance économique doublée d'une croissance démographique et d'une expansion culturelle), « L'énigme grecque, histoire d'un miracle économique et démocratique (VIe-IIIe siècle avant J.-C.) » est un ouvrage qui fascine dès ses 50 premières pages. L'auteur y propose en effet une analogie, qu'il ne faut pas confondre avec une explication, entre les cité-états des rivages de la mer Egée et les colonies de fourmis établies autour d'un étang.
Spécialisation et expertise, voilà pour Josiah Ober, les clés du succès atypique et inédit des cités-états de la Grèce antique. Pour en analyser les causes et surtout la remarquable persistance dans le temps, sur plusieurs siècles, malgré des guerres très nombreuses et un effondrement final de « l'écologie du pouvoir » à la mode des Hellènes, l'auteur nous retrace chronologiquement l'évolution de l'organisation des poleis grecques. Il met en avant les traits spécifiques de régimes démocratiques qui ont su mieux que les autres tirer parti des lieux, de leurs ressources et des hommes qui les habitent. Selon lui, l'explication est ainsi la suivante : « Dans les cités-états grecques les plus développées, des règles relativement impartiales, garanties par l'engagement des citoyens à agir pour les défendre, protégeaient ces derniers (mais aussi d'autres catégories de population) des formes historiquement très communes de domination et d'expropriation. Cela donnait aux individus et aux communautés des raisons d'investir pour leur propre profit. Parmi ces investissements, on trouve l'éducation, le perfectionnement des compétences et le renoncement à des gains à court terme au profit de bénéfices à plus long terme. Le monde grec bénéficiait d'une concurrence intense entre individus et entre communauté mais, dans le même temps, d'institutions et de normes culturelles qui favorisaient une coopération interindividuelle et interétatique à grande échelle et réduisait les coûts de transaction. Cette concurrence et un capital humain accru ont été les moteurs d'une innovation institutionnelle et technologique permanente ».
Le livre s'appuie sur des études chiffrées ou sur des statistiques, elles même basées sur l'ensemble des sources aujourd'hui disponibles. Il en ressort qu'à son apogée, le monde grec antique regroupait 8 millions de personnes, de Marseille jusqu'aux rives de l'Anatolie et de la mer Noire et que leur niveau de richesse moyen n'a ensuite été égalé qu'au XXe siècle. Josiah Ober analyse également les raisons des succès politiques de la Macédoine de Philippe II et Alexandre, qui a réussi là où Sparte, Athènes, Thèbes ou la Perse avait échoué à établir une hégémonie durable, tout en démontrant que la perte d'indépendance des cités-états classiques n'a pas nui à leur prospérité. Le plus surprenant est peut-être d'ailleurs sa conclusion consacrée au phénomène de « destruction créatrice » qui a permis à la civilisation grecque de gagner une forme d'immortalité.
Brillant, foisonnant, original, l'essai de Josiah Ober est à la fois une remarquable synthèse historique et une étonnante étude économique et politique de monde Grec antique. A lire absolument, d'autant plus que les questions soulevées ont aujourd'hui encore une résonance certaine dans nos débats sur la démocratie et l'organisation de nos sociétés.
F.B.
Josiah Ober, L'énigme grecque, La Découverte, 543 pages
Berezina, de Sylvain Tesson

Récit de voyage en side-car Oural, hommage au sacrifice des Grognards de la Grande Armée, ode à la Russie, « Berezina » est tout cela et plus encore. Sylvain Tesson a réussi un livre inspiré, engagé qui pose in fine une seule question : quel peut-être aujourd'hui le terrain d'expression de l'héroïsme ?
C'est de Moscou que Tesson avec ses deux compères français Gras et Goisque et ses deux amis russes Vitaly et Vassili s'élance sur la parcours de la Retraite de Russie, Borodino, la Berezina, Smolensk, Vilnius pour suivre ensuite les traces du voyages retour de Napoléon jusqu'à Paris : « Pourquoi ne pas faire offrande de ces quatre mille kilomètres aux soldats de Napoléon ? A leurs fantômes. A leur sacrifice. En France, tout le monde se fout des Grognards. Ils sont tous occupés avec leur calendrier maya. Ils parlent de la « fin du monde » sans savoir que leur monde est déjà mort ».
L'auteur fait état de la théorie de son ami Gras sur les « hauts lieux » (hauts lieux de la tragédie, hauts lieux spirituels, hauts lieux géographiques, hauts lieux du souvenir, hauts lieux de la création, hauts lieux héraclitéens), mais c'est de son côté obsédé par les souffrances endurées par près d'un million d'hommes que Tesson se lance dans cette folle aventure et de toutes ces horreurs qu'il sait qu'il aura du mal à oublier, à force de les toucher à chaque étape de plus près. Il ne s'en rend compte qu'une fois parvenu en Lituanie : « Les soldats oubliés du charnier de Siaures miestelis avaient été inhumés dans le cimetière en 2003. Pour la première fois, nous abordions un lieu tangible de la Retraite, un espace qui n'était point seulement un décor du souvenir ou un théâtre historique. Il y avait sous cette neige les ossements des hommes dont nous suivions les traces depuis Moscou. Nous cessions de courir après les spectres. Nous nous tenions devant leurs restes ».
Faire la route dans le froid et dans la boue est également l'occasion de plaisirs plus légers : « Ce voyage était certes une façon de rendre les honneurs aux mânes du sergent Bourgogne et du prince Eugène, mais aussi une occasion de se jeter de nids-de-poule en bistrots avec deux de nos frères de l'Est pour sceller l'amour de la Russie, des routes défoncées et des matins glacés lavant les nuits d'ivresse ». Il donne aussi l'occasion à l'auteur d'exprimer son admiration pour le peuple russe : « Ô nous aimons ces Russes. Chez nous, l'opinion commune les méprisait. La presse les tenait, au mieux, pour des brutes à cheveux plats, incapables d'apprécier les murs aimables des peuplades du Caucase ou les subtilités de la social-démocratie et, au pire, pour un ramassis de Semi-Asiates aux yeux bleus méritant amplement la brutalité des strates sous le joug desquels ils s'alcoolisaient au cognac arménien pendant que leur femmes rêvaient de tapiner à Nice. Ils sortaient de soixante-dix ans de joug soviétique. Ils avaient subi dix années d'anarchie eltsinienne. Aujourd'hui, ils se revanchaient du siècle rouge, revenant à grands pas sur l'échiquier mondial. Ils disaient que des choses que nous jugions affreuses : ils étaient fiers de leur histoire, ils se sentaient pousser des idées patriotiques, ils plébiscitaient leur président, souhaitaient résister à l'hégémonie de l'OTAN et opposaient l'idée de l'Eurasie aux effets très sensibles de l'euro-atlantisme. En outre, ils ne pensaient pas que les Etats-Unis avaient vocation à s'impatroniser dans les marches de l'ex-URSS. Pouah! Ils étaient devenus infréquentables ».
En filigrane et au travers des siècles, la présence de Napoléon qui ne manque pas de fasciner Tesson : « Le spectacle était étrange de ces énarques du XXIe siècle, clapotant dans l'entre-soi et la cooptation et dégoisant sur « Le Mal napoléonien » sans reconnaître que l'Empereur avait su donner une forme civile et administrative aux élans abstraits des Lumières ».
Pour terminer, une anecdote raconté par Tesson résume très bien l'esprit de son livre, lorsque face au monument aux morts français de la Bérézina, il raconte : « Le monument me fit penser à cette journaliste de télévision, à qui j'annonçais en direct, quelques mois plus tôt, mon désir de reprendre l'itinéraire de la Retraite et de passer la Bérézina : « Napoléon ? La Bérézina ? Tout cela n'est pas très glorieux », commenta-t-elle. Là, devant la rivière tombale, les mots que j'aurais dû lui jeter me vinrent aux lèvres. Mais j'avais été encore une fois victime de l'esprit d'escalier. « Vraiment chère amie ? Pas de gloire chez les pontonniers qui acceptèrent la mort pour que passent leurs camarades ; chez Eblé, le général aux cheveux gris, qui, sous la canonnade, traversa plusieurs fois le pont pour rendre compte à l'Empereur de l'avancée du sauvetage et mourut d'épuisement quelques jours plus tard ? Pas de gloire chez Larrey, le chirurgien en chef qui fit d'innombrables allers-retours d'une rive à l'autre pour sauver son matériel opératoire, chez Bourgogne qui donna sa peau d'ours à un soldat grelottant, chez ces hommes du génie qui jetaient des cordes aux malheureux tombés à l'eau, chez ces femmes dont Bourgogne écrit « qu'elles faisaient honte à certains hommes, supportant avec un courage admirable toutes les peines et les privations auxquelles elles étaient assujetties » ? Et chez cet Empereur qui sauva quarante mille de ses hommes et dont les Russes juraient trois jours auparavant qu'il n'y avait pas une chance sur un million de leur échapper ? Qu'est-ce que la gloire pour vous madame, sinon la conjuration de l'horreur par les hauts faits ? Au lieu de cela, j'avais bredouillé : Oui, euh, mais tout de même ».
Il y a des livres dont on sait, après seulement quelques pages, qu'ils vont vous transporter (au sens propre comme au sens figuré). C'est le cas de « Berezina », de Sylvain Tesson. Arrivé aux Invalides et à la 200 et dernière page, il ne me vient qu'un mot : Merci.
F.B.
Sylvain Tesson, Berezina, Guérin, 199 pages
Outre-Terre, de Jean-Paul Kauffmann

« Outre-Terre » est un livre particulièrement achevé et réussi. Il aura fallu plusieurs années à Jean-Paul Kauffmann, son auteur, pour finaliser son voyage en famille (avec sa femme et ses deux fils) dans loblast de Kaliningrad et sur le champ de bataille dEylau, à loccasion du bicentenaire de cet événement, en février 2007. Lauteur qui a beau affirmer « je me sens comme un resquilleur. Je ne suis ni un reconstitueur, ni un historien. Je n'ai pas emporté avec moi d'outil conceptuel, j'essaie de me faufiler parmi tous ces experts et tous ces puristes », il est parvenu avec ce livre à nous restituer « en vérité » et avec une profondeur étonnante ce qua pu être la bataille dEylau. Le livre de Jean-Paul Kauffmann se lit dans plusieurs registres et repose sur plusieurs points dappuis : lOutre-Terre (lancienne Prusse Orientale russifiée en 1945), le colonel Chabert de Balzac, le tableau de Gros sur la bataille dEylau, lancienne église dEylau transformée en usine et lombre omniprésente de Napoléon sur cette bataille vieille de deux siècles.
La région de Königsberg (désormais Kaliningrad) est un personnage à part entière. « Sans lOutre-Terre je ne serai jamais revenu à Eylau. Cette enclave est tout ce qui reste du monde des ogres » explique lauteur fasciné par un lieu aussi excentrique que les Kerguelen ou lîle de Sainte Hélène, au cur de ses livres précédents. Jean-Paul Kauffmann capte parfaitement la fameuse âme russe qui plan sur cette terre qui fut pourtant prussienne pendant sept siècles et dont léglise transformée en usine constitue un parfait symbole : « cette ruine industrielle révèle un trait résolument russe : une désagrégation parfaitement endossée. La débâcle, pas la mort. Un refus de baisser les bras. Le brio dans la dèche. Mieux encore, la certitude de se surpasser dans la gabegie, la pagaille, le désastre. Dostojevski prétend que ce nest ni lhiver ni le patriotisme qui ont eu raison de la Grande Armée en 1812, mais lincohérence, la désorganisation de lautre camp. Napoléon a fini par être englouti par le chaos russe ».
Le colonel Chabert, héros du roman éponyme de Balzac, fascine tout autant Kauffmann qui, cela transparait immédiatement, retrouve dans cet homme revenu dentre les morts, une partie de son expérience dotage coupé du monde pendant trois années. « Outre-Terre » est dailleurs aussi un livre introspectif dans lequel lauteur se met en question et expose sa vie familiale de manière simple et très touchante. Quelques autres personnes finissent par faire partie de cette cellule familiale essentielle, comme Julia, linterprète russe qui accompagne lauteur pendant son voyage. Le point essentiel reste une question sans réponse : quest-ce que Jean-Paul Kauffmann est venu chercher à Eylau et que va-t-il finalement y trouver.
La voilà dailleurs cette bataille, racontée par petites touches, comme sous le pinceau dun maître. Kauffmann parvient à nous en transmettre à la fois le souffle épique et qusi-légendaire, lorsquil évoque Murat : « A Eylau comme dans presque toutes les autres batailles, Murat avait coutume de sélancer le premier à la tête de la cavalerie, brandissant non pas un sabre mais une badine avec ce cri : « En avant, direction le trou de mon cul ! » Ses tenues splendides, qui permettaient à lennemi de lidentifier de loin, en faisaient une cible de choix ». Mais il va plus loin, en disséquant ce qui anime le cerveau du personnage central du drame qui se joue à Eylau, Napoléon, « celui dont on pourrait donner cette définition : lhomme qui sait toujours où il en est ».
« Outre-Terre », prend alors une autre ampleur, en envisageant limpossibilité de reconstituer lhistoire, de la faire revivre, de linterpréter et plus encore den extraire une signification. Reste lhistoire des vivants qui ont traversé cette bataille et celle des morts qui sont resté à jamais enseveli sous la terre de région sans revoir « le beau ciel de France ». Kauffmann parvient ainsi à capter à la fois la difficulté de parler encore dune bataille comme Eylau - « Ne sommes-nous pas arrivés à un épuisement de la geste nationale et des grands événements historiques, comme une sorte dassèchement de la mémoire ? Néanmoins, dans cette lente mise à sec, nen déplaise à nos pleurnicheurs dune France à jamais disparue, un fond subsiste, une marque en creux laissée par la trace de quelques moments et de quelques figures, une sorte de fierté » - tout en démontrant, hier comme aujourdhui, combien la trace laissée par lEmpereur a marqué la France : « Napoléon a refait le moral du peuple français, c'est sa gloire la plus vraie. J'adhère totalement à ce jugement de Stendhal. Redonner le moral à un pays profondément traumatisé et ruiné, ce n'est pas rien. Mais ensuite ? ».
Pour aborder lhistoire avec une telle acuité, il faut, Jean-Paul Kauffmann la bien compris, lenvisager avec une réelle tendresse, même lorsquil sagit de la « boucherie dEylau », et plus encore prendre de la hauteur et monter en haut du clocher pour avoir la vue la plus large sur les lieux et les hommes. Y parvenir est une autre affaire, même si « lessai » de Kauffmann est à lui seul un témoignage hors du commun. C'est également le plus beau livre que j'ai lu au cours de l'année écoulée.
F.B.
Jean-Paul Kauffmann, Outre-Terre, Equateurs Littérature, 332 pages
Auguste le révolutionnaire, de Pierre Renucci

Plus (et moins) qu'une biographie, « Auguste, le révolutionnaire », de Pierre Renucci, est avant tout une analyse en profondeur de l'uvre politique du premier empereur romain. « Si la politique est l'art du possible, alors Auguste fut un artiste de talent, car il comprit ce que la société attendait et il lui donna » (page 282) affirme d'ailleurs l'auteur pour justifier le fil conducteur de son ouvrage écrit sur un ton très libre, parfois provocateur, mais toujours dans un style très clair.
Le livre de Pierre Renucci est découpé en quatre grandes parties. Il commence avec la jeunesse du petit neveu de César (ADVLESCENS), fils d'un notable provincial, doté d'une solide éducation, propulsé sur l'avant-scène par l'assassinat des Ides de mars et le testament de son grand-oncle. Vient ensuite, dans les deux parties centrales du livre, a terrible lutte pour le pouvoir au cours le parti césarien, auquel appartient l'héritier de César, triomphe des Républicains (TRIUMVIR) puis la période qui voit le jeune et frêle Octavien se jouer et triompher de Marc Antoine (IMPERATOR CAESAR) pour devenir l'unique maître du monde romain. Les chapitres finaux (DIVVS AUGVSTVS PATER), sans doute les plus importants, décrivent la manière dont celui qui est devenu Auguste parvient à élaborer, instituer et consolider un nouveau régime capable de présider aux destinées de Rome.
L'auteur met sans cesse en avant les formidables aptitudes d'Auguste. Il insiste également sur le pragmatisme et le sens du concret des hommes de sa génération pour mettre fin aux traumatisantes guerres civiles : « Aucun des triumvirs n'était théoricien et n'avait dans ses cartons un projet de constitution nouvelle. La chose peut paraître surprenante à un Français qui même s'il n'est pas spécialiste, sait que depuis la Révolution son pays s'est offert quinze constitutions écrites, dont les rédacteurs étaient à tout coups, sûrs d'uvrer pour l'éternité. Les Romains procédaient différemment et à mon avis plus intelligemment, parce qu'avec un sens aigu du concret. Au cas particulier, n'allons donc surtout pas imaginer que les triumvirs n'avaient aucune idée claire de l'évolution nécessaire à l'Etat qu'ils s'étaient donné la charge de restaurer. Ils savaient au contraire d'où on partait et où il fallait arriver. Précisément, leur opinion commune était que la constitution mixte, où avaient coexisté dans un subtil équilibre les trois composantes aristocratique, démocratique et monarchique n'étaient plus adapté au gouvernement d'un immense empire et que le renforcement de l'Etat passait par celui de la composante monarchique » (page 101).
En spécialiste du droit et des institutions qu'il est, Pierre Renucci explique avec clarté le montage institutionnel inventé par Auguste, une fois seul détenteur du pouvoir. Il parvient habilement à conserver les atours de la République en se réservant imperium maius, princeps auctoritate, tribunicia potestas et sacrosanctitas sans jamais revendiquer la royauté, aspiration (réelle ou imaginaire) qui avait sans doute causé l'échec et la mort de César. Auguste s'appuie aussi et surtout sur des qualités morales essentielles aux Romains : virtus, clementia iusticia, pietas. Le portrait que l'auteur dresse d'Auguste est finalement particulièrement admiratif : « Aucun des triumvirs n'était théoricien et n'avait dans ses cartons un projet de constitution nouvelle. La chose peut paraître surprenante à un Français qui même s'il n'est pas spécialiste, sait que depuis la Révolution son pays s'est offert quinze constitutions écrites, dont les rédacteurs étaient à tout coups, sûrs d'uvrer pour l'éternité. Les Romains procédaient différemment et à mon avis plus intelligemment, parce qu'avec un sens aigu du concret. Au cas particulier, n'allons donc surtout pas imaginer que les triumvirs n'avaient aucune idée claire de l'évolution nécessaire à l'Etat qu'ils s'étaient donné la charge de restaurer. Ils savaient au contraire d'où on partait et où il fallait arriver. Précisément, leur opinion commune était que la constitution mixte, où avaient coexisté dans un subtil équilibre les trois composantes aristocratique, démocratique et monarchique n'étaient plus adapté au gouvernement d'un immense empire et que le renforcement de l'Etat passait par celui de la composante monarchique ». N'est pas Auguste qui veut. Qui a fait mieux ? Où et quand ? Quel chef inspira non seulement à son peuple proprement dit mais à la totalité des nations dont il avait la charge, une telle confiance et un tel dévouement ? Quel homme politique peut se vanter d'avoir donné à sa réussite une ampleur aussi universelle ? Il est certes arrivé que des personnages charismatiques fédèrent leurs nations et conquièrent les voisines. Mais combien en ont ensuite obtenu la comme Auguste l'adhésion sincère ? Charlemagne avait de la trempe, mais aucune idée de ce qu'était un Etat qu'il partagera entre ses fils comme un patrimoine national. Au XIXe siècle, on connait l'Etat, mais cette fois c'est le nationalisme qui étrique les esprits. La Révolution française et Napoléon s'imaginèrent ressusciter l'Empire auquel ils n'avaient rien compris, et ne firent que subordonner pour peu de temps des nations à une autre nation. Et que dire des monstruosités nazie et communistes toutes deux fondées sur le déterminisme historique, si commode pour donner une justification « scientifique » à leur barbarie. Si l'on ajoute à ces exemples récents les empires coloniaux des grandes puissances européennes, on remarque qu'ils ont tous en commun la domination d'un peuple sur d'autres. C'est pourquoi ils n'ont pas duré. Le succès d'Auguste tient précisément à ce qu'il a su éviter le piège fatal de la domination dans lequel s'empêtrait la République. A la place il réalisa cet oïkouménè chère aux stoïciens, c'est-à-dire cette grande communauté humaine qui transcendait mais en les respectant races et peuples. Devenu son chef, il en fit une patrie commune : Roma patria communis nostra » (page 379). On sent chez l'auteur un profond respect et la mesure exacte de la portée de l'uvre augustéenne.
Prenant finalement et volontairement à contrepied le titre de son livre, Pierre Renucci délivre un message fondamental sur la nature de l'Empire romain et son respect fondamental des profondes traditions d'une civilisation remarquable : « Auguste est un révolutionnaire. Pas un révolutionnaire au sens que le monde moderne donne à ce terme. Le Romain n'est ni Robespierre ni Lénine, il n'a pas prétendu faire table rase des données fondamentales de la société, ni changer l'Homme. Sans doute est-ce pour cela que son uvre a été acceptée par une longue suite de générations regroupées dans une multitude de peuples si différents les uns des autres » (page 9). On ne regrettera in fine que le peu de pages consacré à l'homme Auguste et à sa personnalité. De ce point de vue le livre fournit autant de détails, voir plus, sur César, Marc-Antoine, Brutus ou Cicéron. Ce n'est qu'en s'attachant aux problèmes de succession auxquels a dû faire face Auguste que Renucci donne finalement les clés pour comprendre de ce grand homme.
F.B.
Pierre Renucci, Auguste le révolutionnaire, Boutique de l'Histoire, 390 pages
Louis XVI, de Jean-Christian Petitfils
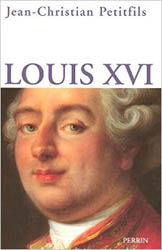
La biographie de « Louis XVI » écrite par Jean-Christian Petitfils est à la fois un ouvrage de sciences politiques et de d'analyses historiques. L'auteur s'attache à toutes les périodes de la vie de celui qu'il appelle Louis le Taciturne, notamment à son enfance et son éducation, pour décrypter ensuite le parcours politique particulièrement semé d'embuches que lui a proposé le destin : « Jamais il ne comprit la force d'un mot, la puissance symbolique d'un geste, l'efficacité d'une mise en scène. Erreur d'éducation, assurément, mais quel prince, élevé dans la tradition, aurait été apte à saisir d'instinct les formes nouvelles de la communication ? » (page 982).
Petifils nous transporte tout d'abord dans les dernières années du long règne de Louis XV pour apprendre à connaître Louis Auguste, son deuxième petit-fils et futur Louis XVI, élevé dans l'ombre maladive de son frère aîné, le duc de Bourgogne qui mourra âgé seulement de 10 ans. Son précepteur, le duc de La Vauguyon est un dévot qui semble issu d'un autre temps. En 1765, c'est au autour de son père Louis Ferdinand de s'éteindre de manière précoce. Son influence posthume, sera néanmoins très importante sur le jeune Louis Auguste qui le remplace comme Dauphin, notamment en lui léguant une liste d'hommes de confiance pour son règne futur mais en laissant son fils bien seul sous la seule influence de La Vauguyon. Vient le temps du mariage avec la jeune archiduchesse autrichienne Antonia (Marie-Antoinette) et les fameuses difficultés « techniques » du jeune couple à consommer son union.
Avec l'arrivée de Louis XVI sur le trône, à l'âge de 20 ans, surgissent immédiatement les premières difficultés et le choix un peu malheureux de rappeler Maurepas qui figurait avec le plus autoritaire Machault sur la liste léguée par son père. Le conseiller du jeune roi affiche les mêmes qualités et surtout les mêmes défauts que son royal élève et ne l'aiderait guère à affirmer son autorité. La première uvre de Maurepas et de convaincre Louis XVI de renvoyer les ministres de son grand père (D'Aiguillon, Terray et surtout Maupeou) puis de rappeler les Parlements dont son prédécesseur avait enfin réussit à briser l'influence conservatrice : « Le jeune homme venait de commettre la première grande erreur de son règne, celle de relever de ses ruines une force d'opposition arrogante, enivrée d'un esprit de revanche, qui allait contrecarrer les indispensables efforts de rénovation de la monarchie qu'il désirait » (page 186).
C'est là que la biographie de Louis XVI de Petitfils prend résolument la tournure d'une méthodique analyse de sciences politiques. Sa ligne directrice est de démontrer comment le roi, intelligent et convaincu des réformes nécessaires, les a laissé échouer les unes après les autres, en étant trop velléitaire et respectueux des usages. Car l'époque est complexe et « les idées nouvelles étaient parfois des idées anciennes, très anciennes, ressurgissant à la faveur d'une sensibilité préromantique nourrie de nostalgies « gothiques ». Dans cette malléabilité idéologique, régression et modernité allaient de pair. On pouvait être à la fois libéral et rétrograde, progressiste et réactionnaire, ouvert d'esprit et farouchement accroché à ses privilèges. Cette union des Lumières et du libéralisme aristocratique, presque totalement négligée des historiens, fut l'un des principaux ressorts de la crise finale de l'Ancien Régime » (page 140). Vient tout d'abord la brève tentative de despotisme éclairé animée par Turgot, puis celle de la monarchie aristocratique avec Necker et enfin la plus concrète rénovation de la monarchie administrative avec Calonne. Mais, après une période de relative réussite, de 1774 à 1787 avec notamment la revanche militaire face à l'Angleterre et le Traité de Versailles qui sanctionne le succès du soutien de la France à l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, la crise majeure du règne va tout emporter.
Le point de départ vient sans doute de l'incapacité du roi à assurer le succès des réformes de Calonne dont il était convaincu de l'utilité vitale : « il parait plus logique et surtout plus fructueux de considérer que la Révolution française débuta à l'été 1786 par cette « Révolution royale », contre laquelle se dressa immédiatement une « Contre-Révolution », prenant la forme d'une fronde aristocratique et cléricale, bientôt relayée par une vigoureuse fronde parlementaire. La question reste de savoir sur cet épisode majeur aurait pu déboucher sur une « révolution sans la Révolution », pour reprendre l'expression de Michel Vovelle » (page 533). Le rappel de Necker va s'avérer catastrophique, en privilégiant la satisfaction de l'opinion contre l'intérêt du peuple : « l'astucieux banquier de Genève avait tous les moyens de faire monter les enchères. Il ne s'en priva pas. Il voulait tout ou rien. Il eut tout. Telle était la situation en cet été 1788, alors que le pays entier semblait s'être ligué contre l'Etat Royal. « Le Parlement, la noblesse et le clergé ont osé résister au roi, disait prophétiquement Lamoignon : avant deux années, il n'y aura plus ni Parlement, ni noblesse, ni clergé ». Sans doute n'était-il pas assez visionnaire pour annoncer qu'avant quatre ans, il n'y aurait également plus de roi... » (page 608).
La dernière partie du livre, consacrée aux quatre dernières années de la vie de Louis XVI, est poignante. L'auteur explique très clairement l'impact de « l'entrée en politique » tardive de Marie-Antoinette, pour aider son mari qui semblait résigné, après avec avoir selon lui tout essayé la désunion du Conseil du Roi et l'instabilité ministériel chronique. Puis vient l'irrésistible glissade qui emporte le roi, le serment du jeu de Paume, la maladroite réaction royale du 23 juin 1789, les journée d'octobre, l'impossible position du Roi des Français, le « voyage de Montmédy », la journée du 10 août 1792, le roi prisonnier, le roi accusé et enfin le roi condamné à mort. La lecture de ces pages met en lumière un point de vue, dont je suis personnellement convaincu depuis longtemps, que la France a raté sa Révolution : « En posant le problème en termes de « métaphysiques », de souveraineté et de monopole de la légitimité, le mouvement révolutionnaire s'était interdit une révolution pacifique vers la démocratie moderne, comme l'avait fait par exemple, un siècle plus tôt, le Royaume-Uni avec le Bill of Rights, qui fixait concrètement - sans réflexion abstraite sur le source originelle de l'autorité - des limites au pouvoir royal, milites qui évoluèrent ensuite au fil du temps, avec la société elle-même. Aujourd'hui encore, la reine en son Parlement, c'est à dire au milieu de ses conseillers, est considérée comme souveraine et source de tous les pouvoirs (the Fountain of powers). La fiction monarchique, avec sa connotation médiévale, sert de support virtuel à la réalité démocratique, l'une des plus solides au monde. La révolution américaine, avec sa Constitution fédérale de 1787 et sa stricte séparation des pouvoir, sut pareillement éviter les flots de sang. Il est vrai qu'elle se déroula dans une société nouvelle, dégagée d'un système de castes rigides » (page 676). Louis XVI n'est pas exempt de fautes, loin s'en faut dans cet échec, comme le fait remarquer l'auteur dans sa conclusion : « En politique, la bonté désarmée mène à la catastrophe. Chez un prince, la lecture de Fénelon ne dispense pas de celle de Machiavel... La perfection évangélique, écrira Charles de Gaulle, ne conduit pas à l'Empire ».
L'analyse post-mortem de l'héritage laissé par Louis XVI est également envisagée avec beaucoup de recul par l'auteur dans les pages finales de la biographie. Celui qui aurait sans doute été le roi idéal d'une monarchie constitutionnelle équilibrée, a finalement été transformé en bouc émissaire (comme dans les sociétés archaïques, voir ce que dit René Girard à ce sujet) et sera immolé par la République naissante d'une France qui se divisa comme jamais, ainsi que le seront 74 des 361 régicides qui s'entre-tuèrent avec entrain après sa disparition. Ambigu, complexe, introverti et impénétrable, Louis XVI n'a selon Petitfils jamais été soutenu par ceux qui auraient naturellement du le faire. Sa modestie, son désir de paix civile, son amour du peuple mais aussi ses connaissances navales ne se seront finalement de manière éclatante que lors de son voyage à Cherbourg en 1786. Sa mort, pleine de courage, de dignité, voire même de sublime grandeur, ne fait néanmoins pas oublier qu'il « a erré, là ou, en tant que prince chrétien, il aurait dû dès le départ montrer plus de discernement et de fermeté ».
Cette biographie magistrale de Louis XVI, écrite dans une langue merveilleuse, est en tout cas palpitante et passionnante à lire de bout en bout, elle ne cède jamais à la moindre facilité ni au moindre raccourci, c'est là tout le talent de son auteur.
F.B.
Jean-Christian Petifils, Louis XVI, Perrin, 1114 pages
1515 Marignan, d'Amable Sablon du Corail
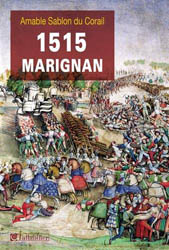
Le « 1515 Marignan », d'Amable Sablon du Corail est un gros volume de 510 pages consacré, en prévision de son 500e anniversaire, à une date et une bataille emblématiques de l'histoire de France telle qu'elle nous fût longtemps contée
Si le thème du livre et son champ d'investigation - l'histoire bataille - semblent très classiques, l'auteur n'en a pas moins réalisé un ouvrage très moderne, dans le bon sens du terme, en intégrant dans son récit et ses analyses personnelles tous les ingrédients d'une recherche méticuleuse, complète et prenant suffisamment de hauteur de recul pour donner tout sa signification à cet événement de deux jours.
Après avoir très rapidement dressé le portrait de la France, de la Suisse et de l'Italie au début du XVIe siècle, Amable du Corail nous emmène dans ses premiers chapitres à la découverte des armées des futurs adversaires. Si les compagnies d'ordonnances françaises sont bien connues avec leurs « lances » de 6 hommes (un homme d'armes, deux archers montés, un coutilier et deux valets), les particularismes des « guerriers » suisses (l'auteur préfère volontairement ce terme à celui de soldat pour les caractériser) qui s'inscrivent dans une véritable culture de la violence le sont moins. L'auteur dresse alors la liste des points forts et des points faibles de chacun : des piquiers et de hallebardiers tournés vers l'offensive en toutes circonstances et un « moral de vainqueur » (au sens que lui donne Ardant du Picq) chez les Confédérés ; une excellente cavalerie, une artillerie moderne et des ressources fiscales supérieures à tous leurs adversaires chez les Français.
Les chapitres suivant abordent les manuvres opératives, le franchissement par un itinéraire inattendu des Alpes par François Ier ou la surprise de Villafranca, et sans doute plus encore, les manuvres diplomatiques qui se poursuivent jusqu'à la veille de la bataille. Un des points que le livre met le mieux en valeur est l'extrême division qui règne alors entre les cantons helvétiques et leurs contingents déployés en Italie, leur attitude partagée vis-à-vis du royaume de France ainsi, enfin, que le rôle décisif du cardinal de Sion, Matthäus Schiner, pour les convaincre de livrer finalement bataille aux français.
Le récit très évocateur et très précis des combats et du déroulement de la bataille constitue le plat de résistance de l'ouvrage. L'auteur a la très bonne idée d'entrecouper son récit chronologique des événements par quelques apartés thématiques sur les chevaux, le harnois blanc, la place du roi dans la bataille, la façon dont les Suisses manient piques et hallebardes et les français leurs lances, l'efficacité des arquebuses ou encore sur l'origine et la tenue au combat des bandes noires de lansquenets mercenaires. Tout cela est rédigé sur un ton particulièrement plaisant et souvent non dénué d'humour qui se caractérise par un rigueur historique de tous les instants, grâce à l'exploitation de textes ou d'archives dont les références sont citées régulièrement en notes.
Victoire brillante d'un jeune roi affable et dynamique, Marignan ne témoigne pas pour autant des suites d'un règne qui sera beaucoup plus difficile et contrasté. « 1515 Marignan » permet en tout cas de comprendre en profondeur ses enjeux et son déroulement, tout comme son exploitation méthodique par la propagande royale au service de François Ier. L'autre mérite de l'ouvrage est de nous plonger concrètement au cur de la bataille et de sa violence dont la réalité peut aujourd'hui nous paraître si étrangère. La conclusion nous éclaire enfin sur les multiples leçons de Marignan : l'importance de l'argent pour faire la guerre, les codes de l'honneur ou l'essoufflement des modèles militaires suisses et français. Le livre s'achève sur la brève évocation de quelques destins individuels.
F.B.
Amable Sablon du Corail, 1515 Marignan, Tallandier, 510 pages
La France pouvait-elle gagner en 1870 ?, d'Antoine Reverchon

Edité dans la collection « Mystères de la guerre », le livre d'Antoine Reverchon intitulé « La France pouvait-elle gagner en 1870 ? » s'attache justement à lever toutes les parts d'ombres qui planent sur ce premier conflit majeur de l'ère industrielle en Europe et sur son issue.
L'auteur l'affirme très clairement dans son introduction : son travail ne relève pas de l'uchronie classique. Il ne s'agit pas en effet pour lui développer un récit d'histoire alternative et crédible, mais plutôt d'explorer, comme le font souvent les joueurs d'histoire avec leurs jeux de simulation, des alternatives concrètes au déroulement des événements réels. Louvrage propose donc une uchronie particulière, au sens quelle ne change pas un seul des événements concrets mais de montre que le cadre matériel et mental permettait des innovations qui, dans la réalité nont pas existé mais auraient pu exister. Le ressort principal du texte est donc l'évaluation de scénarios découlant de changements de choix stratégiques, opératifs ou tactiques tout en conservant les plus strictes contraintes qui sont celles des hommes de l'époque.
Passons rapidement sur les deux premiers chapitres dont la fonction est de décrire précisément les armées en présence, leurs atouts et leurs faiblesses respectives, de comparer leurs doctrines tactiques et de donner un récit assez court, mais complet, des événements réels. L'auteur dresse ici de manière très claire l'état des lieux et ses conséquences sur le terrain. Parmi les points cités, la supériorité numérique des Allemands (Prussiens et leurs alliés), l'avantage technique que confère le fusil Chassepot aux Français apparaissent comme les plus déterminants. Viennent ensuite la portée plus grande de l'artillerie allemande (canons chargés par la culasse) que celle de l'artillerie française qui ne profite guère d'une autre innovation la mitrailleuse Reffye utilisée uniquement en accompagnement des batteries d'artillerie de campagne.
La suite de l'ouvrage est naturellement la plus originale. Antoine Reverchon y décline un scénario tactique et un scénario opérationnel mettant en lumière les leçons que l'armée française aurait pu tirer des faiblesses ennemies mises en évidences par les premiers combats. Les options tactiques - dispositifs défensifs avec tranchée et emploi des mitrailleuses Reffye en première ligne avec l'infanterie sont sans doutes les moins probables. En effet, lorsque l'on sait que les généraux de la guerre de Sécession, moins de dix années plus tôt, n'ont pas tirées d'enseignement des batailles avant les tous derniers moins de la guerre (tranchées autour de Petersburg) et que les chefs des armées de 1870 n'ont pas non plus exploité les informations des observateurs envoyé en Amérique, on peut être dubitatif sur des changements au bout de quelques semaines, voire de quelques mois. Si lidée de la tranchée figurait bel et bien dans le règlement de linfanterie édicté sous le maréchal Niel après la guerre de Crimée (il est demandé aux troupes de creuser des « tranchées-abris » sur les positions défensives sur le champ de bataille) les pelles ne sont même distribuées aux soldats à cet effet. Après la mort de Niel et son remplacement par Leboeuf, cet élément du règlement est dailleurs négligé dans les manuvres et par les officiers (qui le jugent « contraire à lhonneur »). Le « What if ? » opératif, basé sur un repli organisé de l'armée de Napoléon III devant Paris, évitant ainsi le désastre fatal de Sedan est quant à lui à la fois très pertinent et pleins d'enseignements (dans ses limites, car il aurait sans doute permis au mieux un match nul, comme le suggère l'auteur).
Le livre se termine sur une analyse particulièrement complète des efforts de la Défense nationale, après la chute de l'empire : récit des campagnes historiques et leçons à extraire de celle-ci. En partant de ses éléments Antoine Reverchon explore deux options stratégiques alternatives : une offensive de l'armée de la Loire mieux organisée et surtout mieux coordonnée avec les efforts de l'armée de paris ; une offensive concentrique coordonnée des toutes les armées de provinces (avec notamment une action sur les lignes de ravitaillement allemandes plus efficace). Ces scénarios reprennent aussi les hypothèses d'évolution des doctrines tactiques et opératives énoncées dans les chapitres précédents pour permettre d'évaluer leurs résultats. Dans les deux cas, l'objectif politique est d'amener la Prusse à négocier et à accepter une sorte de paix blanche, assortie de garanties.
« La France pouvait-elle gagner en 1870 ? », écrit dans un style très clair, est un livre qui atteint les objectifs qu'il s'était fixé. Il va même un peu au-delà en évoquant les conséquences possibles d'une autre issue de la guerre de 1870 sur les futures guerres mondiales du XXe siècle. Les hypothèses avancées le sont de manières précises et avec un souci constant de faire référence concrète au monde historique réel (par exemple dans l'énoncé des unités et le calendrier de leur emploi). Le rôle possible de certain généraux on pense à Trochu ou Bazaine est lui aussi établi à l'aune de leurs caractères, de leurs capacités et de leurs penchants politiques. La hiérarchisation des alternatives à l'histoire en fonction des échelles (au niveau tactique, opératif, stratégique, ou diplomatique) est sans doute une des meilleures idées du livre. Certains chapitres sont par contre très techniques et rédigés dans un style assez difficile (accumulation de chiffres, de dates, de numéros d'unités etc.) qui, pour le moins, nécessite un lecteur très attentive et le soutien d'une carte. De ce côté aussi, quelques schéma supplémentaires aurait sans doute permis une compréhension plus facile des scénarios analysés. Il reste à saluer l'initiative d'un tel ouvrage qui ouvre une historiographie du conflit, souvent très académique, vers d'autres méthodes et d'autres horizons souvent négligés en France.
F.B.
Antoine Reverchon, La France pouvait-elle gagner en 1870 ?, Economica, 192 pages
La guerre romaine, de Yann Le Bohec

« La guerre romaine, 58 av. J.-C.-235 apr. J.C. », de Yann Le Bohec, est un livre important. Relativement bref et concis, il dresse néanmoins un tableau particulièrement riche et complet de son sujet. Lauteur fait le point, dans une première partie relativement classique, sur larmée romaine en tant quinstitution, sur sa composition et sur son organisation.
Le Bohec, et cest là que son livre prend plus dampleur, sattache ensuite à analyser les emplois tactiques, opératifs et stratégiques des légions et de leurs auxiliaires. Il évoque notamment la « facies victoriae » décrite par Tacite, expression que lon retrouve récemment, presque à lidentique, chez l'historien britannique John Keegan avec sa « Face of Battle ». A l'autre extrémité du spectre de son étude, l'auteur en vient à envisager également ce qu'il appelle la « métastratégie » : le regard que portent les philosophes sur la guerre. Pour Le Bohec, lapport des légionnaires à lEmpire est immense : « Quant aux soldats, en fin de compte, ils ont joué un rôle très important dans les provinces de garnisons, c'est-à-dire dans les régions frontalières. Ils ont entouré l'empire d'une ceinture de prospérité et de romanité » ; ou encore, « suant et souffrant pour l'Etat, combattant pour l'empire, les légionnaires se considéraient comme les seuls vrais citoyens romains (et d'ailleurs c'est sans doute bien ce qu'ils étaient : les seuls). Pour eux les prétoriens et les habitants de la Ville, n'étaient que des dégénérés, soucieux de leurs loisirs et de leur nourriture ». Lauteur se plait ensuite à mettre en valeur les qualités des légionnaires, et notamment la notion de discipline, chère aux Romains dans ses deux acceptations : le sens du métier (de soldat) et lobéissance.
Si Le Bohec réfute le lemploi du terme « grande stratégie » pour lEmpire romain, il ne rejette pas pour autant l'ensemble des thèses d'Edward Luttwak relatives à la « grande guerre ». Pour la « petite guerre », l'auteur fait notamment référence aux travaux de David Galula et dHervé Couteau-Bégarie pour expliquer lusage que Rome en a fait, notamment dans une dimension de contre-guérilla, cruelle mais efficace.
Louvrage de Le Bohec est également remarquable de par son souci permanent de donner à chaque mot son vrai sens. Il signale par exemple, que lemploi du mot attrition est sans doute erroné lorsquil s'agit dun état dans lequel seul un des deux belligérants est écrasé. Il indique aussi que le terme limes nétait pas en usage dans lEmpire où lon parlait de fines (frontières) ou de ripa (quand la frontière est matérialisée par un fleuve).
Enfin, le texte de Le Bohec laisse un peu place à un humour au second degré très réjouissant et à quelques tonitruantes remises en causes : le visage de Trajan comme général est ainsi qualifié de « celui de la médiocrité habillée par une habile propagande », lauteur lui préférant les grands organisateurs et réformateurs que furent Auguste ou Septime Sévère. Sa conclusion tient en un mot : adaptabilité. Pour l'auteur, « l'explication des succès de l'armée romaine tient à une question de mentalité collective, une étonnante adaptabilité. Nous avons vu plus haut combien les Romains étaient respectueux des coutumes. C'est que les hommes de l'Antiquité étaient, comme tous leurs semblables jusqu'à la Renaissance, fondamentalement conservateurs ».
F.B.
Yann Le Bohec, La guerre romaine, 58 avant J.-C. - 235 après J.-C., Tallandier, 447 pages
Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, de Johan Huizinga et Wargames from Gladiators to Gigabytes, de Martin Van Creveld
Deux livres, le premier ancien et en français le second récent et en anglais, abordent chacun à leur manière l'histoire du jeu en général, et celle du jeu de guerre en particulier, comme une forme essentielle de la culture hulaine.

« Homo Ludens », écrit en 1938 par l'historien néerlandais Johan Huizinga est aujourd'hui un classique d'une profondeur historique et d'une clarté prophétique. Pour l'auteur, l'homme est un « Homo Ludens » plus qu'il n'est un « Homo Sapiens ». Le jeu dans toutes ses formes est pour lui plus ancien que la culture, il est tout simplement constitutif de cette dernière.
Huizinga développe tous les éléments qui permettent de comprendre la nature du jeu et sa signification, pointant ensuite son aspect compétitif, mais source d'échange, dans les fameux « potlatch » que Claude Lévi-Strauss avait également si bien analysé. Viennent ensuite les questions des liens entre le jeu la guerre et les mythes : « La notion de guerre n'apparait en somme que lorsque qu'une situation spéciale, grave, d'hostilité général se trouve distinguée des querelles individuelles et, jusqu'à un certain point, des brouilles de famille. Semblable distinction place la guerre non seulement non seulement dans la sphère sacrée mais aussi dans la sphère agonale. Ainsi la guerre est élevée au niveau d'une cause religieuse, d'une confrontation générale des forces et d'un décret du destin ; en bref, elle est englobée dans ce domaine où le droit, le destin et le prestige se trouvent confondus. Ainsi, elle entre dans la sphère de l'honneur » (page 138) ; « Le mythe, quelle qu'en soit la forme transmise, est toujours poésie. Il relate, avec les moyens de l'imagination, des événements qu'on représente comme réellement survenus. Il peut être chargé du sens le plus profond et le plus religieux. Il exprime peut-être des rapports, rationnellement indescriptibles. En dépit du caractère sacré et mystique, propre au mythe dans la phase de culture à laquelle il répond, tout en admettant qu'il fut accepté avec une sincérité absolue, il est permis de se demander si un mythe peut jamais être qualifié de tout à fait sérieux. Il l'est pour autant que la poésie puisse l'être. Avec tout ce qui outrepasse les bornes du jugement logique, poésie et mythe se meuvent dans le domaine du jeu. Ce qui ne signifie pas : dans le domaine inférieur. Il peut arriver que le mythe, en se jouant, atteigne des sommets inaccessibles à la raison » (page 184).
Mais c'est dans l'analyse du couple jeu-sérieux, dans toutes les dimensions de la culture, que le livre d'Huizinga prend toute sa portée. L'auteur passe en effet en revue la profonde marque agonale qui caractérise la sagesse, la poésie, l'imagination au sens large, la philosophie et finalement la plupart des disciplines artistiques. Il propose ensuite une analyse critique des civilisations historiques sous l'angle du jeu. Frappé par les dérives du monde de la première moitié du XXe siècle qui est le sien Huizinga affirme que « La surestimation du facteur économique dans la société et dans l'esprit humain était, en un sens, le fruit naturel du rationalisme et de l'utilitarisme qui avaient tué le mystère et déclaré, l'homme affranchi de faute et de péché. On avait oublié, cependant, de l'affranchir de la sottise et de la mesquinerie, et il apparut apte et disposé à faire le salut du monde à l'image de sa propre banalité » (page 264) et voit malheureusement la guerre apparaître désormais sous un nouveau jour « Par la perfection de ses moyens, la guerre est devenue l'ultima ratio, une ultima rabies. Dans la politique d'aujourd'hui, qui se base sur une extrême prévoyance - et s'il le faut - sur une extrême préparation du combat, on reconnaîtra difficilement l'ombre de la vieille habitude ludique. Tout ce qui relie la guerre à la solennité du jeu lui a également fait perdre sa place en tant qu'élément de culture » (page 288).
La conclusion de l'ouvrage est entièrement centrée sur le dilemme jeu-sérieux, avec pour exemple les évolutions « professionnelles » du sport ou de certains jeu à la mode : « La place du bridge dans la vie contemporaine indique en apparence un renforcement inouï de l'élément ludique dans notre culture. En réalité, tel n'est pas le cas. Pour jouer vraiment, l'homme doit redevenir un enfant pendant la durée de son jeu. Peut-on constater ce phénomène dans la pratique d'un pareil jeu d'esprit raffiné à l'extrême ? Faute d'une réponse positive, le jeu se trouve alors dépourvue de sa qualité essentielle » (page 273). Reste néanmoins la valeur universelle du jeu, action libre, sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante et qui peut tant apporter au joueur : « Tout énoncé d'un jugement décisif n'est pas reconnu pour tout à fait concluant dans la conscience personnelle. A ce point où le jugement chancelle, s'évanouit le sentiment du sérieux absolu. Au lieu du Tout est vanité millénaire, un Tout est jeu, d'un accent un peu plus positif, s'impose peut-être alors. Cela ne paraîtra que métaphore à bon marché, que pure impuissance de l'esprit. Pourtant, c'est là la sagesse à laquelle Platon avait atteint, lorsqu'il nommait l'homme un jouet des dieux. Par un détour étrange, la pensée retourne au Livre des Proverbes. Là, la Sagesse Eternelle, source de justice et d'autorité, dit cavant toute création elle jouait à la face de Dieu pour le divertir, et que dans le monde de son royaume terrestre elle trouvait ses divertissements parmi les enfants des hommes » (page 291).
Rarement un livre avait allié aussi bien histoire, jeu et sagesse. Nous pouvons le louer pour cela.
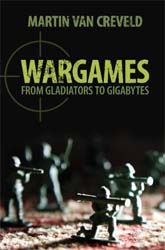
Le dernier livre de l'historien et théoricien militaire israélien Martin Van Creveld, pour l'instant disponible uniquement en anglais, est quant à lui entièrement consacré aux wargames. Derrière ce terme qui nous est cher, l'auteur adopte une définition très large du concept : « Un wargame peut être défini comme un jeu de stratégie qui, bien que clairement distinct des réalités de l'art de la guerre par plusieurs de ses caractéristiques, simule néanmoins quelques composantes clés de celui-ci : notamment, et assez souvent, la mort, la blessure ou la capture qui découle de ses éléments fondateurs, c'est à dire le combat ».
Son travail consiste en une étude historique des nombreux développements des « jeux de guerre », dans une approche radicalement opposée à celle de la « théorie des jeux ». En ce sens, son livre est assez éloigné de ceux de James Dunningan, Mark Herman ou plus récemment Philip Sabin, pour se placer dans la filiation du « Homo Ludens » de Johan Huinzinga, en analysant la place des jeux dans les sociétés humaines. Van Creveld débute son livre sur l'étude des formes que prennent les « jeux » de combat dans le monde animal, pour ensuite glisser vers l'analyse des combats sans armes ou des combats rituels, ouverts à tous, dans l'humanité primitive, qui a ensuite évolué vers les combats de champions. L'auteur consacre ensuite de très nombreuses pages aux gladiateurs. D'abord descriptif, sur les formes diverses que prennent les spectacles organisés principalement par les Romains au cours de l'antiquité et pouvant aller jusqu'à de véritables « reconstitutions de batailles », l'auteur devient analytique pour explorer les fonctions des combats de gladiateurs qui s'affirment comme une preuve de pouvoir (pour l'Empereur), de piété (pour les editores qui les organisent) et une façon de faire de l'argent (pour les lanistae qui possèdent et entraînent les combattants). Van Creveld passe ensuite en revue toutes les formes historiques qu'ont pu prendre les wargames. Il évoque ainsi, au travers de l'anecdote, du combat entre Jean de Carrouges et Jacques le Gris racontée par Froissart, comment le Jugement de Dieu se place dans le domaine de la justice. A l'inverse, les tournois médiévaux deviennent un phénomène de classes, dans lequel excellent des nobles quasi-professionnels, comme ce fut le cas de Guillaume le Maréchal, dont Georges Duby a tant parlé : « finalement les tournois, en particulier les plus grands et les plus importants, ressemblent à beaucoup d'autres formes de jeu de guerre en cela qu'ils servent un théâtre socio-politique » explique Van Creveld. L'auteur passe ensuite à l'étude des duels, en vigueur du XVIe siècle jusqu'à 1914 et de leur lien aux questions d'honneur. Avec la modernité, les mutations du wargame deviennent plus radicales : on passe de jeux avec des vrais hommes et des vraies armes à des systèmes de simulation moins dangereux. La révolution des armes à feu, entre 1450 et 1520 tend en effet à empêcher, par sa dangerosité immédiate, le wargame en grandeur réelle.
Van Creveld étudie alors en détails l'histoire de jeux de guerre plus virtuels, au premier rang desquels les échecs, dont la pratique est quasi universelle. Le wargame devient aussi progressivement un exercice préparatoire à la guerre. La campagne de Tannenberg de 1914 est la première à avoir été « jouée » avant son déroulement dans le monde réel. L'auteur souligne ainsi l'importance de l'école prussienne de Kriegspiel. Après la Seconde Guerre Mondiale ce sont les Américains, et surtout l'U.S. Navy, qui occupent la première place en termes de wargames. Dans le domaine purement ludique, air soft et paintball rivalisent avec les jeux sur carte ou sur ordinateur. L'informatique fait son entrée dans le monde du wargame via les simulateurs globaux de la Guerre Froide. Elle permet ensuite la mise au point de véritables simulateurs de combat et de « shooting games ». L'histoire, très riche, des jeux informatiques, de Space Invaders à Tank ou Call of Duty n'a pas de secrets pour l'auteur qui en profite pour évoquer des problèmes moraux, à propos du scandale provoqué par Medal of Honor en permettant au joueur de tirer sur des troupes de son propre pays.
Le chapitre sur les femmes et les jeux de guerre est sans doute la meilleure partie du livre avec celle sur les gladiateurs. Affirmant que « pour tout ce qui concerne le wargame, l'homme et la femme sont des espèces différentes » Van Creveld analyse les raisons pour lesquelles seulement 1,6% des grands maîtres aux échecs sont des femmes qui désertent par ailleurs le monde du jeu d'histoire sur carte. Il y voit la conséquence d'un véritable choix, les femmes étant avant tout intéressées par le monde réel, plus motivant que le monde virtuel, pour tisser des liens sociaux. Van Creveld conclu son livre magistral et passionnant sur le point suivant : les wargames ont de tous temps reposé sur 4 fondements (religion, justice, entraînement et divertissement) et ont mobilisé les armes de pointe de leur temps (épées, armes à feu, ordinateurs).
F.B.
Johan Huizinga, Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Tel Gallimard (2011), 292 pages
Martin Van Creveld, Wargames from Gladiators to Gigabytes, Cambridge University Press (2013), 332 pages
The First Clash, de James Lacey
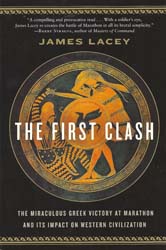
« The First Clash » de James Lacey est consacré à la bataille de Marathon, mais peut-être plus encore aux enseignements qui peuvent être tirés des premiers affrontements entre l'empire perse et les cités grecques d'Ionie, de la mer Egée et du continent européen.
L'auteur, et cela conditionne en grande partie le contenu de son étude, est un officier américain qui a notamment servi dans les 82nd et 101st Airbone Divisions en Irak et en Afghanistan. De ce fait, il fait souvent référence à sa propre expérience de combattant quand il s'agit de commenter les réalités du terrain, quelle que soit l'époque dont il est question.
Sur les 200 pages de texte de son livre, écrit dans un style très abordable, Lacey consacre les 100 premières à planter le décor et à remettre dans leur contexte les événements de l'année 490 av. J.-C. L'auteur insiste notamment sur le rôle essentiel joué par Sparte dans le refus de céder aux ambitions des Perses, cela de manière directe ou indirecte (par exemple en faisant pression sur les Eginètes pour favoriser les Athéniens).
Les 50 pages suivantes font état de la prise de position courageuse et honnête de James Lacey dans le débat sur « Le modèle occidental de la guerre » entre son promoteur, Victor Davis Hanson et ses opposants, au premier rang desquels John Lynn. Lacey explique de manière très pragmatique sa « conversion » progressive, au fil de son parcours personnel, en faveur des thèses défendues par Hanson, tout en exprimant les quelques réserves qui lui semblent nécessaires.
Enfin, les 50 dernières pages sont consacrées à une reconstruction la plus complète possible de la bataille de Marathon et de commentaires sur son déroulement. Lacey s'intéresse de près aux aspects logistiques autant qu'aux combats et à leurs suites. De manière une nouvelle fois très concrète, il aborde ensuite les grands points de controverses qui animent les historiens qui se sont intéressés à la bataille de Marathon, en proposant également son propre point de vue sur la présence ou non de la cavalerie perse, l'identité du réel commandant de l'armée athénienne, la localisation du camp perse ou le mouvement des Perses autour du cap Sounion après la bataille. Le point de vue personnel le plus intéressant apporté par Lacey est probablement celui qu'il consacre à la question de la distance sur laquelle des hoplites lourdement équipés peuvent courir.
F.B.
James Lacey, The First Clash: The Miraculous Greek Victory at Marathon and Its Impact on Western Civilization, Bantam, 233 pages
Chiclana-Barrosa, 5 mars 1811, de Natalia Griffon de Pleineville

« Chiclana-Barrosa, 5 mars 1811 » entre par la grande porte dans la collection des « batailles oubliées » de l'éditeur Historic'One. Russe d'origine, spécialiste de la Guerre d'Espagne, sur laquelle elle a déjà beaucoup écrit, Natalia Griffon s'attache cette fois à décortiquer le déroulement de la bataille de Chiclana-Barrosa et son impact sur le siège de Cadix, entrepris un an auparavant par les soldats du Ier corps de l'armée impériale française.
Le plan de ce livre de 110 pages est classique : point sur la situation stratégique et sur les forces en présence, intentions des deux adversaires, premiers engagements, déroulement des combats, pertes des deux camps et conséquences de la bataille. Le volume s'achève par quelques observations de l'auteur sur la bataille et ses points les plus controversés (page 72 : « la bataille de Chiclana-Barrosa a ceci de remarquable que tous les participants, Français, Anglais et Espagnols ont clamé avoir remporté la victoire contre des forces supérieures ! »), et par un guide du champ de bataille, tel que l'on peut encore le visiter aujourd'hui. Des encadrés, sur une demi-page ou une page complète est consacrée aux principaux chefs des deux camps. En annexes, les lecteurs les plus exigeants trouveront ordres de bataille, tableaux d'effectifs et relevés de pertes exhaustifs. Les illustrations, notamment les planches originales et en couleur de Florent Vincent sont magnifiques. A noter également de nombreuses photos des lieux prises directement par l'auteur.
Tout l'intérêt du livre vient de la précision du récit des événements, avec à l'appui de nombreuses citations de témoins de ceux-ci : le lecteur peut suivre, grâce à un texte rigoureux, avec plusieurs cartes en appui, les mouvements de chaque bataillon, de chaque escadron ou de chaque batterie. Les opérations, pourtant complexes (les Espagnols et les Anglais sont convoyés par mer pour débarquer au sud des lignes françaises et leurs opérations, pour briser le blocus Cadix, doivent être coordonnées avec les actions de la garnison), sont restituées avec clarté et hauteur de vue. L'auteur développe également de manière très vivante les péripéties de la bataille : l'échec de la sortie depuis Cadix, ordonnée trop tôt par Zayas, le combat conduit sur des positions très périlleuses par Villatte, les choix difficiles de Victor qui manque cruellement d'hommes, la blessure du général Ruffin, les divergences de vues entre l'Anglais Graham et l'Espagnol Lapeña, l'efficacité du tir en lignes des Britanniques face aux attaques en colonnes des Français et enfin la relation complète de l'événement le plus emblématique de la bataille, à savoir la capture par les Irlandais du 87th regiment de l'Aigle du 8e régiment de ligne français.
Fait exceptionnel pour qu'il soit signalé en passant, l'auteur a écrit directement les deux versions de l'ouvrage - en français et en anglais - dans un très beau style et sans passer par une traduction.
F.B.
Natalia Griffon de Pleineville, Chiclana-Barrosa, 5 mars 1811, Historic'one, 112 pages
Wargaming for Leaders, de Mark Herman, Mark Frost et Robert Kurz
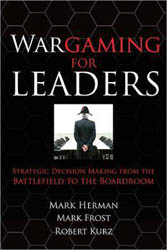
« Wargaming For Leaders » analyse les apports du jeu (de guerre) comme méthode de réflexion ou de planification au sein de grandes entreprises privées ou d'organisations publiques et militaires. Les trois auteurs font état de leur expérience dans le domaine au sein du cabinet Booz Allen, et pour l'un d'entre eux (Mark Herman) en tant que créateur de plus d'une cinquantaine de wargames historiques, publiés et commercialisés à destination du grand public.
L'ouvrage s'appuie sur toute une série d'exemples commentés d'utilisation de ces jeux par des équipes de décisionnaires (en général, plusieurs équipes par jeu). Les auteurs expliquent tout d'abord leur méthode pour mettre au point ces (war)games, le plus souvent inspirée de situations à l'origine militaire. L'évaluation des résultats se fait grâce à l'élaboration de trois ensemble de décisions clés (plus rarement cinq) couvrant chacun la simulation d'une période de temps plus ou moins grande. Les thèmes abordés sont très divers. Ils vont des recherches de solutions pour sortir de la guerre du Golfe ou pour faire évoluer la stratégie de défense du territoire américain après le 11 septembre à des analyses stratégiques sur les politiques énergétiques (intérêt de la prospection des gaz de schiste), les plan de continuité de l'activité, les politiques de santé (gestion des pandémies) ou de sécurité dans les ports américains.
Les auteurs s'attachent à montrer les particularités de la pratique du wargame qui n'a pas grand-chose à voir avec celle des brainstormings ou des réunions au sommet. Pour eux, « le pouvoir des wargames est de créé un monde virtuel duquel les joueurs peuvent retirer des expériences, apprendre, intégrer des acquis pour leur propre processus de décision tactique et stratégique ». Le jeu devient alors un moyen de simuler les scénarios du futur pour mieux l'explorer et faciliter la prise de décision.
« Wargaming For Leaders » est écrit dans un anglo-américain clair, précis, concret et abordable. La liberté de ton des auteurs est très appréciable, tout comme le sont les résumés et les listes de retours sur expérience proposés au sein de chaque chapitre.
F.B.
Mark Herman, Mark Frost et Robert Kurz, Wargaming for Leaders, Mac Graw Hill, 275 pages
L'armée romaine sous le Haut-Empire, L'armée romaine dans la tourmente et L'armée romaine sous le Bas-Empire, de Yann Le Bohec
En trois ouvrages, Yann Le Bohec a dressé l'étude la plus complete en langue française sur l'histoire de l'armée de la Rome impériale. Comme l'auteur se plait à le rappeller, l'histoire militaire a retrouvé une véritable crédibilité depuis perte d'influence des historiens imprégniés de la vulgate marxiste qui l'envisageaient avec au contraire avec certain dédain.
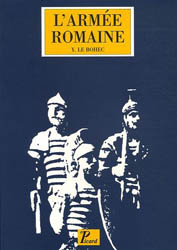
L'ouvrage de Yann Le Bohec consacré à « L'armée romaine sous le Haut-Empire » (1989) est, les plus ancien des trois. Il est aussi, aujourd'hui encore, la meilleure synthèse existante sur le sujet. Le grand mérite de ce livre est de partir de sources et de les expliciter pour ensuite aborder la nature et l'organisation des différentes unités de l'armée. L'auteur se préoccupe aussi de la question du recrutement, de l'exercice, de la tactique et de la stratégie. La dernière partie du livre est consacrée à l'histoire à proprement parler de l'armée romaine du haut empire et de ses rôles militaires, matériels et culturels.
Le livre est agrémenté de tableaux particulièrement complets et bien faits qui permettent de comprendre et de suivre l'évolution du nombre de légions et leur répartition sur les frontières de l'Empire. Le style est agréable, les schémas explicatifs très clair. Ce livre est une belle réussite, dans la lignée des ouvrages précédents de Le Bohec. .

« L'armée romaine dans la tourmente » (2009), analyse de son côté la « crise du IIIe siècle », au sens large du terme. En effet, l'armée romain est encore celle d'Auguste, mais son environnement, lui a totalement changé.Le Bohec, rappelant les méfaits de la focalisation de beaucoup d'historiens modernes sur la seule notion de « longue durée » (il signale d'ailleurs au passage que Braudel, son inventeur, l'avait mise très justement en perspective avec les « temps court » et le « temps moyen »), met tout d'abord en évidence la réalité de cette crise entre 230 et 285, avec un point culminant sous Gallien autour de 258. La thèse de l'auteur, défendue dans le livre de manière très méthodique, s'articule autour de plusieurs points : une crise des finances publiques, directement liées aux augmentations exponentielles de la solde des militaires sous Septime Sévère, Caracalla, Alexandre Sévère et Maximin le Thrace, avec de dramatiques et invisibles (pour les gouvernements de l'époque) conséquences inflationnistes ; une augmentation des périls extérieurs avec le renforcement des Germains (ligues des Francs, Alamans et des Goths, meilleurs armements) et des Iraniens (objectifs agressifs des Sassanides, armée plus efficace) ; une obligation nouvelle pour Rome de combattre sur plusieurs fronts et enfin une crise d'adaptation de l'armée romaine à cette nouvelle situation.
Sur le plan strictement militaire, Yann Le Bohec, analyse la situation de façon méthodique en s'appuyant sur des tableaux listant les attaques extérieures et les guerres civiles par années et par secteurs. Il évoque aussi en détails les changements survenus chez les ennemis de Rome et les velléités sécessionnistes de certaines parties de l'Empire. Par ailleurs, l'armée romaine d'Auguste, qui a atteint son maximum d'efficacité sous Septime Sévère, a ensuite été moins performante, du fait d'un recrutement moins exigeant et d'un manque d'adaptation face à la montée en puissance de ses adversaires. Par ailleurs, l'auteur démontre aussi la fiction de certaines réformes attribuées à Gallien (comme le concept mobile « mobile ») ou Valérien, repoussant l'amélioration de la situation à la politique réactionnaire (au sens premier et non péjoratif du terme) de Dioclétien.
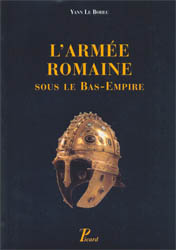
Le dernier ouvrage de la trilogie , intitulé « L'armée romaine sous le Bas-Empire » (2006) s'ouvre de manière inédite sur un cahier de 45 pages de cartes, schémas, dessins et illustrations consacrés au sujet. Bien qu'entièrement en noir et blanc, cet encart, et notamment ses cartes, est particulièrement utile pour faciliter la lecture des chapitres suivants.
Yann Le Bohec organise son étude en débutant par un regard sur l'armée de Dioclétien, réactionnaire plus que réformateur en matière militaire, puis sur celle de Constantin. Après avoir évoqué leurs campagnes et celles de leurs successeurs jusqu'à Julien, l'auteur rentre dans les détails pour aborder les questions relatives aux unités, au recrutement, à la stratégie, aux tactiques, à l'architecture militaire de cette époque. Il s'intéresse également aux ennemis de Rome, leurs mutations et leur montée en puissance. Le livre reprend ensuite un caractère chronologique en traitant des règnes de Valentinien, Valens et leurs ultimes successeurs. La thèse générale développée par Le Bohec s'appuie sur quelques idées fortes : Les ennemis de Rome sont parvenus au IVe et Ve siècles à un niveau de puissance inédit, la menace des barbares, l'agressivité de leurs raids ou invasions et les ravages qu'ils ont causé ont été bien réels, les guerres civiles ont aggravé la situation, la crise conjoncturelle qui a frappé l'empire d'occident, alors que l'empire d'orient continuait s'enrichir a accéléré la crise militaire et l'effondrement du premier, l'armée romaine, qui a fait face à une profonde crise de recrutement des hommes de troupes comme des officiers, s'est avéré de moins en moins efficace et s'est finalement désintégrée en occident, les citoyens romains ont de plus en plus laissé le soin à d'autre de se battre à leur place, en enfin l'empire d'orient s'est débarrassé sans vergogne de bien des barbares en les dirigeant volontairement vers l'occident.
Le style de Yann Le Bohec rend très vivantes les 250 pages du livre. Analyses générales et récits se complètent à merveille et avec une grande force d'évocation, comme lorsque l'auteur signale, en marche des pages consacrées aux années postérieures à la grande invasion de 406 que les chefs barbares installent leurs résidences dans les camps romains abandonnés. La persistance et l'humour avec lesquels l'auteur lutte contre la mode récentes des réhabilitations en tout genre (des mauvais empereurs, des barbares en général, de l'absence de crise au sein l'empire ) est par ailleurs plutôt vivifiante.
Signalons in fine les références bibliographiques impressionnantes qui se trouvent en fin de chacun de ces trois ouvrages, faisant d'eux un outil de travail autant qu'une référence incountournable sur leur sujet.
F.B.
Yann Le Bohec, L'armée romaine sous le Haut-Empire, Picard, 287 pages
Yann Le Bohec, L'armée romaine dans la tourmente, Editions du Rocher, 320 pages
Yann Le Bohec, L'armée romaine sous le Bas-Empire, Picard, 256 pages
Comment l'Occident pourrait gagner ses guerres, de Pierre-Marie Léoutre

Ce qui frappe en premier lieu à la lecture de « Comment l'Occident pourrait gagner ses guerres », un essai de 120 pages de Pierre-Marie Léoutre, c'est la détermination de l'auteur pour asséner et défendre ces idées : pour lui, et on n'entend plus si souvent ce message, l'armée doit avant tout se préoccuper de gagner les guerres au lieu de se diluer dans un rôle humanitaire ou de bâtisseur.
Léoutre analyse d'abord de manière classique les spécificités historiques de la conduite de la guerre et la manière dont l'ont envisagé les pays occidentaux depuis des siècles. Il démontre ensuite que, depuis 1945, les armées occidentales se sont préparées quasi exclusivement du fait des stratégies de dissuasion nucléaire à des guerres qui n'auraient jamais lieu (des affrontements entre corps de bataille des deux blocs dans les plaines d'Allemagne ) alors qu'elles n'étaient ni préparées, ni équipées pour conduire avec succès les guerres auxquelles elles ont du réellement faire face (notamment pour la France, l'Indochine et l'Algérie, pour les Etats-Unis le Vietnam)..
L'auteur analyse également les mutations des principes de la « guerre révolutionnaire » depuis que l'idéologie djihadiste à remplacé l'idéologie communiste sur les principaux lieux de confrontations. Pour répondre à ces défis auxquels sont confrontés les Occidentaux, notamment en Irak puis aujourd'hui en Afghanistan, et éviter une défaite sur le long terme, Léoutre propose de se réapproprier les leçons et l'expérience acquise par les Français en Indochine et en Algérie, comme l'ont déjà fait en partie les Américains, puis de développer, avec les palettes d'armes et de communication nouvelles du XXIe siècle, une stratégie de guerre de contre-insurrection novatrice, mais nourrie au plus profond d'elle-même des acquis historiques évoqués plus haut..
Dans la partie, sans aucun doute la plus intéressante et originale de son essai, l'auteur décline ensuite les ressources de la « guerre psychologique » et des stratégies d'influence, en analysant leur rôle dans les révolutions dites « colorées », ou leurs avatars, qui ont eu lieu dans les républiques de l'ex-URSS (Géorgie, Ukraine, Kirghizstan, Biélorussie, Azerbaïdjan, Russie etc.) ou plus récemment et de manière moins lisibles, dans le monde arabo-musulman. Financement, fonctionnement, rôles des slogans et des logos sont ainsi disséqués, du Vietminh aux Pussy-Riot ! Citant Jacques Ellul, Léoutre évoque le recours au mythe simplificateur « une organisation d'images capables d'évoquer tous les sentiments qui correspondent aux manifestations du mouvement à soutenir en vue d'une action totale que le mythe colore d'une vie intense et qui provoque l'union intuitive du sujet à l'objet et des sujets entre eux ». De tout ces éléments, l'auteur dégage des pistes solide pour agir, réagir, réfléchir et gagner des conflits, grâce à des stratégies actualisées de contre-insurrection, qui font en grande partie déjà partie de nos savoir faire, mais dont nous semblons parfois vouloir refuser l'héritage..
En annexe, l'auteur publie le texte intégral d'un discours, sublime de clarté et d'intelligence prononcé par De Lattre le 11 juillet 1951 à la cérémonie de distribution des prix du Lycée Chasseloup-Laubat d'Hanoï. Quelle leçon !.
F.B.
Pierre-Marie Léoutre, Comment l'Occident pourrait gagner ses guerres, Le Polémarque, 120 pages
Une histoire moderne des croisades, de Jonathan Phillips
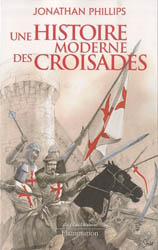
Avec « Une histoire moderne des croisades », l'historien britannique Jonathan Phillips propose une vision globale de l'histoire des croisades et de son influence profonde sur les relations entre le monde occidental et le monde arabo-musulman.
Le livre déroule tout d'abord l'histoire factuelle des croisades franques vers la Terre Sainte, de manière synthétique, mais néanmoins précise. Les motivations des Croisés sont ainsi analysées en seulement 5 pages alors que des auteurs comme Jean Flori y ont consacrés récemment des ouvrages entiers. Le récit des différentes croisades est assez bref, mais il est très bien écrit et présente de manière efficace et compréhensible les enjeux stratégiques de chacune..
Jonathan Phillips choisit par ailleurs de mettre en avant un certain nombre personnages emblématiques qui chacun à leur manière font prendre des virages radicaux à l'idée de croisade : Mélisende, Richard Cur de Lion, Frédéric III et Saint Louis d'un côté, Saladin et Baybars de l'autre. L'ouvrage fait par ailleurs preuve d'une certaine originalité en mettant systématiquement en perspective l'histoire des croisades stricto sensu (vers le Levant) avec un spectre plus large d'opérations militaires en Espagne, dans la Baltique ou contre les Cathares. Philips s'attache aussi à démêler les conséquences, dans le déroulement des croisades, de la lutte d'influence entre l'Eglise et la Papauté d'un côté et les souverains séculiers européens de l'autre..
Enfin, c'est probablement dans ses derniers chapitres qui portent sur « l'ombre des croisades » sur l'histoire mondiale que l'auteur se montre le plus novateur. Son analyse porte sur la persistance, le prolongement ou le détournement de l'image des croisades à travers les siècles et les continents. Critiquée et rejetée avec véhémence au XVIIIe siècle, le concept de croisade fait un retour en force en Occident au XIXe siècle, tant dans les romans de Walter Scott que les expéditions militaires françaises en Algérie (sous Charles X) ou en Syrie (sous Napoléon III), les campagnes anglaises de Gordon au Soudan ou le voyage du Kaiser Guillaume II à Jérusalem. Dans la première moitié du XXe siècle la quasi-totalité du monde musulman passe d'ailleurs sous les coupe des puissances occidentales, donnant naissance par ricochet à un nationalisme arabe tout d'abord laïc (Nasser, Assas, ou Saddam Hussein) puis récemment de plus en plus religieux et inspiré par le jihad..
L'histoire des croisades de Jonathan Phillips est in fine « moderne » parce qu'elle nous invite, dans la lignée des recommandations politiques de Churchill, à nous éveiller au passé pour éviter des catastrophes futures : « les événements qui se déroulèrent en tant de lieux et qui impliquèrent tant de millions d'individus se sont inscrits dans la conscience de l'Occident chrétien et du Proche-Orient musulman. Etant donné la nature intrinsèque du jihad dans l'islam, ils ne disparaîtront jamais, mais la croisade a pris fin ( ) Depuis des siècles nous ne connaissons plus que l'ombre des croisades et non leur vraie forme ».
F.B.
Jonathan Phillips, Une histoire moderne des croisades, Flammarion (Au fil de l'histoire), 516 pages
Naissance, vie et mort de l'Empire romain, de Yann Le Bohec
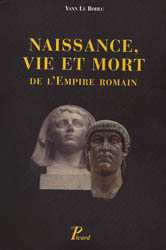
Le nouveau livre de Yann Le Bohec, intitulé « Naissance, vie et mort de l'Empire romain » est un véritable pavé (850 pages). L'objet de cet ouvrage est de tenter une nouvelle approche pour expliquer la naissance du Principat, l'évolution de ses structures puis les causes de la chute de Rome et de son empire. Loin de toutes simplifications ou thèses préfabriquées, l'auteur prend le parti d'une véritable analyse multicritères, en abordant les unes après les autres toutes les composantes de la société impériale : les dynasties successives, à partir d'Auguste, et les formes de leur exercice du pouvoir, l'armée, les villes, les campagnes, les provinces, les religions, l'économie (et la question de la production de l'énergie), enfin la grande crise qui commence au troisième siècle et ses limites.
Le Bohec se permet une totale liberté de ton, exprime clairement sa pensée, sur des points importants aussi bien qu'à propos de petites anecdotes : « L'Etat romain n'a jamais rien imposé, sauf l'ordre, et surtout pas la « romanisation ». En associant les élites locales au pouvoir et en multipliant les citoyens romains, l'Empire assura la paix intérieure ; quant à la paix extérieure, elle fut confiée aux légions. L'ordre fut renforcé par de multiples moyens : le droit évitait les vendettas, les loisirs et la culture séduisaient les populations et la prospérité, liée à l'ordre et à la paix, justifiait l'oubli de l'indépendance. N'en déplaise à quelques historiens, l'Afrique fut romanisée et prospère et, pour ces raisons, elle fut un fleuron de l'empire », écrit-il par exemple dès la page 14. Ou encore : « En Egypte, le porc était absent des cours de ferme parce qu'il était considéré comme impur. Quelques personnes, à l'heure actuelle, proposent une explication : cette viande aurait été interdite car elle ne se conservait pas sous ce climat. C'est évidemment faux : le saucisson peut-être gardé pendant des mois, ce à quoi aucun aliment analogue ne peut prétendre. En fait les interdits religieux sont par définitions irrationnels. L'homme peut-il comprendre les exigences de Dieu ? Ou des Dieux ? ». Enfin, dernier exemple : « Des historiens ont récemment fait remarque que les barbares n'étaient que 100 ou 200 000, moins de 300 000 dans tous les cas, et ils ont assurés qu'ils n'étaient pas méchant du tout. On nous permettra de rappeler que la guerre n'est jamais un moment de bonheur pour les peuples que la subissent et que de nombreux témoignages vont à l'encontre d'une image de barbares sympathiques ».
Le livre n'est pas non plus dépourvu d'une certaine forme d'humour irrévérencieux lorsque l'auteur affirme par exemple que « Les Romains n'ont jamais égalé, et de loin, la bureaucratie qui dirige la France du XXIe siècle » ou lorsqu'il s'attache aux travaux d'Edward Luttwak : « Edward Luttwak a présenté « la grande stratégie de l'empire romain » dans un livre qui a été traduit dans toutes les langues et même en français, avec deux éditions (...) L'ouvrage fut d'abord bien accueilli, comme en témoignent les premiers comptes rendus, tous favorables. Puis quelqu'un s'aperçu que cet Américain d'origine roumaine était viscéralement anti-communiste ; bien plus, il fut embauché par le président Ronald Reagan comme conseiller en matière stratégique. Aussi plusieurs historiens examinèrent-ils l'ouvrage avec un Ïil plus critique, ce qui leur permit de découvrir deux points faibles : l'auteur n'était pas un antiquisant, et il avait travaillé sur des ouvrages de seconde main (on ne put pourtant pas lui reprocher d'avoir fait de mauvais choix, car il avait lu de bons livres). Quelques chercheurs allèrent plus loin en niant l'existence même d'une stratégie dans l'Antiquité : les empereurs et leurs conseillers ne disposaient pas de cartes ni de documentation sur les ennemis, et leurs système frontalier relevait tout entier de l'empirisme. Si les uns ont attaqués Edward Luttwak, d'autres le défendent et, à l'heure actuelle, la bataille fait rage ».
Sur les facteurs à l'origine de la mort de l'Empire, les aspects militaires son largement évoqués par Le Bohec qui affirme « le pouvoir politique ne pouvait pas se passer d'une armée performante ; il eut l'une des meilleures armées connues de l'histoire de l'humanité. Mais elle devint envahissante. Elle se mêla des affaires de l'Etat, et surtout elle obtint des salaires qui ruinèrent les finances publiques ». Il pointe ainsi les augmentations de la solde des légionnaires, sous Domitien, mais ensuite et surtout sous Septime Sévère et Caracalla, puis Maximin le Thrace : « Enrichissez-les soldats et moquez-vous du reste » aurait dit Septime Sévère à ses fils. L'auteur montre le relâchement qui gagne l'armée, symbolisé par la décision d'Alexandre Sévère d'alléger le paquetage des légionnaires au moment même où les Perses Sassanides (infanterie lourde) et des Germains (ligues et amélioration de l'armement) font leur révolution militaire et deviennent autrement plus redoutable que dans le passée. A cette cause de déclin visible, s'ajoute celle invisible de l'inflation galopante qui gagne l'Empire au IIIe siècle. Le Bohec rappelle enfin que « l'esclavage ne représentait pas la principale force de production de l'époque (...) Les historiens actuels, en général dégagés du credo marxiste, admettent que les esclaves ne représentaient que 10% environ de la population totale ».
Enfin, Le Bohec, tout en montrant l'importance de la « longue durée » se fait aussi à rappeler l'importance décisive de certains événements ou certaines décisions, souvent minimisée par d'autres historiens, et la rapidité de l'évolution de l'Empire en conséquences : l'importance du facteur militaire (systématiquement sous estimé en France), le partage définitif en deux empires, la résignation à laisser s'installer définitivement des peuples germaniques au complet dans l'Empire ou l'ampleur inédite des dévastations de la grande invasion consécutive au franchissement du Rhin par les Alains, les Vandales et les Suèves en 406. Le Bohec s'efforce aussi de mettre en avant l'efficacité des actions, certes souvent empiriques, mais guidées par le sens du devoir et l'attachement indéfectible à la romanité de nombreux « grands » empereurs.
Brillant, très bien présenté (avec une Problématique et une Conclusion clairement identifiées dans chaque chapitre), éclairé par de nombreux tableaux ou schéma, « Naissance et mort de l'Empire romain » s'inscrit comme un grand livre de Le Bohec, voire même l'un de ses meilleurs, d'autant plus qu'il apparait comme une synthèse de plusieurs de ses précédents travaux.
F.B.
Yann Le Bohec, Naissance, vie et mort de l'Empire romain, Picard (Antiquités / Synthèses), 847 pages
Lost Battles et Simulating War, de Philip Sabin
Le professeur en études stratégiques Philip A. G. Sabin, du King's College de Londres, a mené jusqu'à aujourd'hui une carrière très reconnue d'historien militaire. Ses domaines de prédilections concernent l'antiquité, la seconde guerre mondiale et la stratégie aérienne. Philip Sabin est également, un expert éclectique de la simulation des conflits. Il a par ailleurs contribué à l'ouvrage collectif « Cambridge History of Greek and Roman Warfare » (Cambridge University Press, 2007) et a publié de nombreux articles, dont un particulièrement remarqué sur « The Current and Future Utility of Air and Space Power » (Royal Air Force Air Power Review, 2010). Il s'y s'essaye à la prospective, en recourant notamment aux principes déjà utilisés dans ses recherches sur l'antiquité. Au cours des cinq derniéres annnées, il a également de publié deux livres consacrés aux jeux de simulation historique.
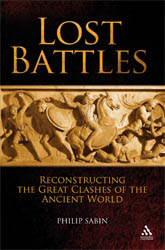
« Lost Battles » a constitué, dès sa sortie en 2007, un véritable événement dans le monde du jeu d'histoire et a conduit à sa réédition dès 2009. Tout l'intérêt de l'ouvrage réside dans l'explication très détaillée de la conception d'un véritable modèle de « reconstruction » des batailles antiques. Ce choix, longuement argumenté, réside dans la volonté de créer un système suffisamment « générique » pour permettre des comparaisons sur un échantillon suffisamment représentatif de batailles. Sabin met par ailleurs en avant plusieurs points selon lui déterminants, comme l'importance du commandement ou le niveau de pertes extrêmement disproportionné entre vainqueurs et vaincus. Ce dernier élément le fait douter de la réalité des longues périodes de mêlées et d'escrime, sur la ligne de front, qui auraient justement équilibrées les pertes entre les protagonistes. Pointant les contradictions des sources antiques, en prenant l'exemple de la bataille de l'Hydapses et des récits d'Arrien, de Curtius et de Polyaenus, Sabin choisit également de faire l'impasse sur les travaux postérieurs « d'exégèse » et notamment sur les auteurs du XIXe siècle, comme Delbrück par exemple, pour ne retenir dans ses recherches que les travaux de ses contemporains. La première partie du livre s'attache dès lors à évaluer autant que faire ce peut les réalités de l'art antique de la guerre au travers des armées, de leurs capacités de mouvement ou leurs aptitudes de combat. Sabin recourt ensuite à un niveau assez élevé d'abstraction afin de bâtir son modèle de reconstruction des batailles à l'échelle grand tactique. Il cherche à se dégager des incertitudes qui émanent des sources en suggérant par exemple « que l'on se concentre sur les effets des combats tels que décrits dans les récits eux-mêmes » plutôt que d'extrapoler sur leur déroulement. La seconde partie de l'ouvrage couvre la reconstruction, selon les principes évoqués, de 35 batailles de la période de 500 ans allant de Marathon à Pharsale. Elle est dans sa forme assez répétitive et gagne à être abordée en allant d'une bataille à l'autre, selon ses goûts, plutôt que par une lecture systématique. On y découvre aussi que Sabin est lui aussi contraint à faire des choix qui s'avèrent « personnels », par exemple pour valoriser des unités entre recrues ou vétérans ou pour reconstruire le terrain. Dans une certaine mesure, et c'est inévitable, Sabin donne ainsi sa propre compréhension des sources dans un modèle qui ne peut pas être exclusivement « scientifique ». La conclusion du livre fait ainsi ressortir sa vision des clés de la bataille antique : la notion de force (effectifs et qualité des unités engagées), les contraintes liées à l'espace (le terrain et son utilisation), la notion de temps (trop souvent négligée dans les travaux de nombreux historiens) et enfin le facteur décisif du commandement. Innovant, créatif et toujours appuyé sur des argumentations très bien étayées, « Lost Battles », le livre, constitue un travail majeur dans l'historiographie récente consacrée à l'art de la guerre de l'Antiquité.

Le nouveau livre de Philip Sabin, « Simulating War », se présente à la fois comme une réflexion sur le jeu et la guerre mais aussi comme une véritable histoire didactique et commentée du « wargame ». L'auteur aborde toutes les catégories du jeu d'histoire - sur carte, avec figurines ou sur ordinateur pour se concentrer ensuite sur les plus satisfaisantes, historiquement et ludiquement. Philip Sabin place le « wargame » au confluent de trois activités récréatives que sont le jeu en lui-même (jeu de plateau, jeu sur ordinateur, sport ), la simulation (maquettisme, reconstitution ) et l'intérêt pour les affaires militaires (lectures, visites de champs de bataille ). Simulating War s'attache dès lors en profondeur aux aspects théoriques de son sujet : partant de Clausewitz, pour qui « dans toute le champ des activités humaines, la guerre est ce qui ressemble le plus à un jeu de carte », ou de Luttwak qui a analysé la logique paradoxale de la stratégie au travers des uvres antiques, celle de Végèce plus particulièrement, Sabin analyse la naissance et les évolutions récentes du jeu d'histoire sur carte. Le livre est écrit en anglais - dans un style très abordable et se donne à l'évidence pour objectif de faire comprendre au plus grand nombre, et pas spécifiquement à ceux que l'on appelle les « grognards », les différentes applications du jeu d'histoire. L'auteur, qui est rappelons le professeur au King's College de Londres, développe plus particulièrement son argumentation à propos des utilisations possibles du jeu d'histoire dans le domaine éducatif. Dans la partie théorique du livre, Philip Sabin nous guide pas à pas dans la compréhension des questions fondamentales du monde du jeu d'histoire : techniques de modélisation, arbitrages nécessaires entre simplicité et historicité, nature des recherches préalables. Les chapitres consacrés aux mécanismes décrivent de manière très pratique la démarche de création d'un jeu d'histoire. Enfin, Philip Sabin évoque des exemples précis de jeu, d'abord sur la période antique au travers de ses propres créations, puis de manière plus large sur la seconde guerre mondiale (« terre promise » du jeu d'histoire, en raison de la quantité de sources et témoignages disponibles) et enfin sur les simulations à l'échelle tactique. Toujours en quête de hauteur et de recul dans ses propos, l'auteur s'intéresse aussi à des questions d'ordre morale sur le « wargame », signalant les problèmes que peuvent poser des sujets trop contemporains, trop polémiques ou donnant une vision trop romantique de la guerre. En conclusion, Philip Sabin, visiblement peu convaincu de l'intérêt du gigantisme insiste sur le fait que les jeux d'histoire sur carte peuvent avantageusement chercher à être simples, bon marché et rapides à joueur, que même des jeux simples peuvent brillamment simuler des aspects concrets de conflits réels et qu'enfin les jeux d'histoire sur carte peuvent être conçus ou développés par des non-professionnels, pour des besoins éducatifs. Le livre contient toute une série d'annexes et d'illustrations, ainsi que des compléments téléchargeables gratuitement pour les besoins de ses « travaux pratiques ». Il s'appuie enfin sur une bibliographie particulièrement riche en livres, en articles et en jeux d'histoire.
F.B.
Philipe Sabin, Lost Battles, Rconstructing The Great Clashes of The Ancient World, Continuum (2007), 298 pages
Philip Sabin, Simultaing War, Studting Conflict Through Simulation Games, Continuum (2012), 363 pages
Prêcher la croisade, de Jean Flori
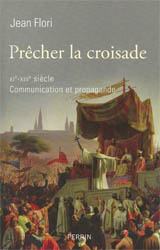
Grand spécialiste des idéologies guerrières des XIe et XIIe siècles, Jean Flori nous propose, avec « Prêcher la croisade », un nouveau texte de référence sur les motivations des croisés. L'auteur démontre que les arguments matériels n'ont jamais prédominé et explique de manière lumineuse pourquoi autant de personnes, issues de tous les milieux, ont décidé de prendre la route pour aller délivrer Jérusalem. Mais, si trouver les mots pour convaincre un Champenois ou un Normand de contribuer à recouvrer le Saint Sépulcre semble facile, le convaincre d'aller mourir pour aller sauver Edesse semble beaucoup moins évident.
Toujours au plus près des sources, détaillant les caractéristiques des arguments de chacun des grands prédicateurs du XIe au XIIe siècle, l'auteur met en évidence l'évolution de leurs discours. On y découvre les intentions et les objectifs des prêches et les glissements idéologiques successifs de l'idée de croisade : pèlerinage, expédition militaire, moyen d'obtenir la rémission de fautes confessées, guerre juste, concession de l'indulgence, quête de récompenses spirituelles promises, impact de la notion de purgatoire... L'auteur démontre la captation par la Papauté, en grande partie réussie, de l'entreprise des croisades, même si quelques mouvements populaires parviennent un temps à court-circuiter le Saint Siège. Jean Flori se distingue également des ouvrages habituels en redonnant toute sa signification à l'argument eschatologique de nature apocalyptique qui domine à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, avant de décliner par la suite.
Le livre s'organise en 15 chapitres. Il commence par décrire les fondements idéologiques des croisades, les premiers appels et le message très spécifique d'Urbain II. Un chapitre est ensuite consacré à chacune des 8 grandes croisades ainsi qu'à d'autres événements (la croisade des Enfants) ou personnages particulièrement notables (Innocent III ou Saint-Louis). Avec plus de 500 pages, dont une centaine consacrées en annexe à des documents d'époque traduits et à une bibliographie particulièrement riche, « Prêcher la croisade » fait le tour de son sujet comme on ne l'avait jamais encore fait.
F.B.
Jean Flori, Prêcher la croisade, communication et propagande, Perrin, 526 pages
La religion des Spartiates, de Nicolas Richer
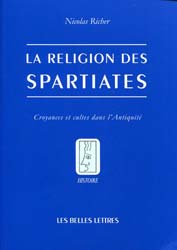
Le présent ouvrage est essentiel pour comprendre que la sensibilité religieuse lacédémonienne a, sans aucun doute, été d'un degré supérieur à celle des autres Grecs. Le livre reprend notamment des faits évoqués dans Soldats et Fantômes, sur la protection attendue des ancêtres. Chez les Spartiates, le rôle des morts est strictement codifié et hiérarchisé. Le degré de protection attendu des défunts, est classé de manière croissante, dans l'ordre suivant : anonymes ; hilotes morts au combat ; périèques mort au combat ; femmes appartenant aux hiérai ; Spartiates morts au combat ; Spartiates morts au combat dont la qualité s'est révélée dans l'épreuve ; chefs spartiates particulièrement méritant, comme Eurybiade ou Brasidas ; rois ; personnages exceptionnels, tel Pausanias enfin un roi, Léonidas, mort de façon « idéale ». L'auteur explique à ce sujet la place très spécifique accordée à Léonidas et Pausanias dans la société spartiate.
Le lien entre excellence militaire et religion des Spartiates est analysé de la manière suivante. Dabord sur les principes : « La façon dont les Spartiates savent se rendre les dieux propices en temps de guerre relève de leur science militaire : c'est parce que leur mode d'action à l'égard des dieux est particulièrement systématique, qu'ils peuvent être vus comme des spécialistes de la guerre ne négligeant rien pour être victorieux ; le professionnalisme inimitable de leur logique peut consister notamment à faire qu'un descendant de Zeus sacrifie aux dieux » (page 252). Lauteur insiste ensuite sur le lien entre la frontière et les croyances : « L'importance accordée aux sacrifices de franchissement de la frontière peut s'expliquer par la conscience aiguë de passer d'un domaine du ressort de certaines entités surnaturelles à un autre : l'acte de franchissement d'une limite requiert en lui-même une approbation des dieux » (page 210). Il explique également louverture des Spartiates aux autres croyances du monde Grec : « Il semble bien qu'un trait caractéristique des manières de penser des Lacédémoniens consiste dans la recherche systématique de l'appui des puissances divines attachés à un lieu » (page 222). L'ouvrage nous plonge également au cur des principales fêtes locales : les Hyakinthies, les Gymnopédies et bien entendu les très importantes Karneia, commémorations annuelles de la présence spartiate en Laconie. Le livre évoque aussi les rituels à caractère militaire, comme les combats des jeunes spartiates au Platanistas.
La première de ces fêtes est celle des Hyakinthies qui chez les Lacédémoniens scandent l'écoulement du temps : « La célébration des Hyakinthies est une symbolique initiatique qui rappelle les Théséia attiques : la fête doit être notamment destinée à assurer l'intégration de la jeunesse au corps social » (page 382). Au cours des Hyakinthies, les maîtres invitent leurs esclaves pour des repas. Le renversement temporaire de l'ordre social, de la hiérarchie entre maîtres et esclaves parait d'ailleurs typique d'une volonté de donner un départ nouveau à la société. Il y a léquivalent chez les Romains avec les Saturnales.
Pour la seconde grande fête spartiate, les finalités sont plus clairement militaires : « Les Gymnopédies, commémorer la victoire de Tyrhéa. Assurer aussi des unions permettant la mise au monde d'hommes dignes de ce nom.. Actes dont elles étaient l'occasion ont revêtu une orientation religieuse, en l'honneur d'Appolon Pythaeus. Chants montrant le souci chez les Spartiates de perfectionnement à finalité militaire » (page 420). A noter que les célibataires nont pas le droit de participer aux Gymnopédies (véritable sanction). La fête donne par ailleurs lieu à des représentations chorales et au chant du péan. Par ailleurs, « Le caractère militaire (mais athlétique et sans armes) de certaines danses peut contribuer à expliquer limage donnée de Sparte comme étant un camp militaire » (page 422).
La fête lacédémonienne la plus importante, et sans doute la mieux connue est celle des Karneia : « Ainsi, l'objet même des Karneia semble avoir été de célébrer l'arrivée des Doriens (et de leurs chefs Héraclides, prétendument descendant d'Héraclès donc liés à Thèbes) dans le Péloponnèse. La fête des Karneia pouvait donc être considérée comme une célébration d'un événement fondateur de la communauté de Sparte. Du fait de ce caractère même, cette célébration était sans doute sentie comme nécessaire à la perpétuation de la collectivité. L'importance de la fête est d'ailleurs mises en valeur par la façon dont, en de nombreux cas, des opérations militaires souhaitées par les Spartiates n'ont pas eu lieu parce que ceux-ci tenaient avant out à célébrer les Karneia » (page 444). Lauteur se soucie aussi de replacer les fêtes spartiates dans le temps. La « reconstruction » dun calendrier complet est dailleurs proposée en annexe : « Alors que les Hyakinthies - qui probablement, s'achevaient au moment de la pleine lune suivant l'équinoxe de Printemps - étaient une fête de renouvellement de l'année (et du monde), les Karneia étaient une célébration - fondées sur les cadres sociaux des Spartiates - visant à réaffirmer, chaque année, la présence spartiate en Laconie par une sorte de commémoration de l'arrivée dans le Péloponnèse des Doriens et de leurs chefs Héraclides » (page 454).
La suite porte notamment sur les combats rituels livrés par les jeunes spartiates au Platanistas (page 498 et suivantes). Organisés sur plusieurs jours, ces cérémonies débutent par le sacrifice des chiots à Enyalios (la nuit). Puis vient un tirage au sort nocturne pour déterminer par quel pont chaque groupe va rentrer dans l'île. Il y a ensuite des combats de sangliers et un sacrifice à Achille dans la nuit qui suit. Le rituel s'achève par le combat des jeunes gens réparti en deux équipe au milieu du jour, avant des chants et danses au son de l'aulos. L'auteur signale que les combats du Platanistas sont plus violents encore que le pancrace ou le pugilat. Ces combats ritualisés ont pu servir à confirmer des pouvoirs royaux, ou à délivrer un avertissement aux détenteurs de ceux-ci. C'est une pratique se retrouve également, en Macédoine, à Rome et dans l'Inde védique où les pouvoirs des rois sont censés pouvoir être renforcés à l'issue d'une compétition rituelle opposant deux groupes d'hommes (pratiques indo-européennes, voir les travaux du G. Dumézil).
Le livre de François Richer nous permet ainsi de pénétrer au plus profond des convictions des Spartiates et de percevoir comment ils ont vu dans leurs succès militaires hors normes les manifestations d'un système politique, social et religieux particulièrement efficace. Le système religieux des Spartiates, au sein duquel les femmes jouent un rôle important, se révèle comme un véritable moteur de leur histoire.
F.B.
Nicolas Richer, La religion des Spartiates, Les Belles Lettres, 795 pages
The Face of Battke, by John Keegan

Dans ce livre, John Keegan aborde la question de « la bataille » et de son récit. Comment décrire la guerre, quelque soit les époques, et les mots pour permettre de mieux la comprendre.
Après avoir analysé en quoi et pourquoi les textes des témoins ou des historiens militaires sont depuis toujours parcellaires ou idéalisés, généralement pour des raisons historiquement recevables d'ailleurs, l'auteur tente à son tour d'exposer clairement à ses lecteurs les réalités de la bataille.
Pour cela, John Keagan s'attache à trois batailles emblématiques de trois époques différentes, sur lesquels les sources sont particulièrement nombreuses : Azincourt (1415), Waterloo (1815) et La Somme (1916). Pour chacune d'entre elle, l'auteur propose un récit des événements puis sa traduction concrète au niveau des acteurs de la bataille : qu'ont-ils vu, qu'ont-ils compris, de quelle manière ont-ils combattu, quelles ont été leurs blessures ou quel ont été les conséquences morales et psychologiques de la bataille sur eux ?
La démarche de Keegan est systématique et analytique. Il dresse un typologie concrète des formes d'affrontement : cavalerie contre cavalerie, cavalerie contre infanterie, cavalerie contre artillerie, infanterie contre infanterie, infanterie tirant (arcs, fusils, mitrailleuses) contre infanterie tirant, artillerie contre infanterie, artillerie contre artillerie Si à Azincourt, les combattants sont confrontés à trois seulement de ces situations, les soldats de Waterloo le sont aux sept. Pour ceux de la Somme, les choses sont encore dramatique plus « simples », les fantassins n'ayant pour adversaires que des barrages d'artillerie ou des nids de mitrailleuses.
L'ouvrage de Keagan, qui date de 1976, est devenu aujourd'hui un véritable classique, à cause du renouvellement de « l'histoire bataille » qu'il a suscité en replaçant le lecteur sur le terrain et en lui faisant partagé les impressions concrètes des acteurs de ces batailles. Keegan a fait école, « Le modèle occidental de la guerre » de Victor Davis Hanson prolongeant par exemple ces travaux pour la période de la guerre hoplitique des cités grecques antiques.
Lu en anglais, l'ouvrage démontre par ailleurs une force particulière dans ses mots et sa construction, il s'agit en fait également d'un vrai travail littéraire, dans un style magnifique. La traduction française (Anatomie de la bataille) date de 1993. A lire absolument, je l'ai exploré de mon côté avec beaucoup trop de retard...
F.B.
John Keegan, The Face of Battle, Pimlico, 352 pages
Courtrai, 11 juillet 1302, de Xavier Hélary
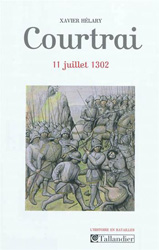
Le « Courtrai, 11 juillet 1302 », de Xavier Hélary dépeint avec force et détails la célèbre bataille des « éperons d'or ». Point d'importance, le livre démythifie quelque peu la victoire de milices flamandes, ensuite largement exploitée par divers courants de propagande. Tout d'abord, l'armée française qui a livré bataille ce jour là n'était qu'un avant-garde, de taille relativement modeste, de l'ost royal.
Par ailleurs, isolée au milieu des victoires de la chevalerie française à Furnes (1297), à Mons-en-Pévèle (1304), à Cassel (1328) et enfin et surtout Roosebeke (1382), le succès des Flamands à Courtrai devrait être mis en avant du fait de son caractère exceptionnel, au sens premier du terme. Comme l'explique l'auteur, « vers 1300, le noble français reste le parangon de la chevalerie ». Un autre aspect transgressif de cette bataille a marqué les esprits : les Flamands ne font pas de quartiers pour rançonner les chevaliers, comme l'usage le voulait alors et les chefs français sont massacrés sur le champ de bataille. La mort de Robert II d'Artois à Courtrai, neveu de Saint Louis a un énorme écho sur son temps, comme ce fut déjà le cas pour celle de son père à la bataille de Mansourah (1250).
L'analyse précise des circonstances de la bataille nous éclaire aussi sur les causes de l'échec des troupes de Robert d'Artois. Les milices flamandes armées de leur traditionnel goedendags, soutenues par un petit millier de nobles et de gens d'armes sont parvenus à vaincre des chevaliers français qui ont trop vite perdu leur élan et qui ont été incapables de se reformer « en bataille », sur un terrain trop coupé pour cela. Précis et factuel, l'ouvrage parvient ainsi à clarifier le déroulement des combats de Courtrai. Malgré un manque certain de cartes, il réussit également, à partir de sources souvent contradictoires, à en expliquer de manière très convaincante leur issue dramatique. Le livre se conclu par une analyse de la « mémoire » de la bataille au travers des siècles.
F.B.
Xavier Hélary, Courtrai, 11 juillet 1302, Tallandier (L'histoire en batailles), 208 pages
La double mort du roi Louis XIII, de Florence Hildesheimer

Déjà biographe émérite de Richelieu, Françoise Hildesheimer s'appuie sur son exceptionnel connaissance de la période pour s'intéresser plus spécifiquement ici à la courte période qui va de la mort de Richelieu à celle de Louis XIII. Son objectif est clairement défini : « Contrairement à une légende tenace, Richelieu s'est révélé non pas le maître du roi, mais sa créature dévouée, toujours menacée de disgrâce. C'est bien Louis qui décidait de la politique inspirée et mise en ouvre par le principal ministre ( ). Comment faire disparaître l'omniprésent Richelieu pour accéder au roi, son maître ? ( ) Et la solution était simple : s'immerger dans les six mois qui séparent la mort du cardinal, le 4 décembre 1642, de celle du roi, le 14 mai 1643. Six mois qui constitue un quasi-vide historiographique » (page 11).
Le livre fait une grande place au rapport des hommes du XVIIe siècle avec la mort et ses conséquences : « En matière de santé et de vie, les hommes du XVIIe siècle disposaient d'aucune assurance et vivaient dans une quotidienne et inéluctable familiarité avec la mort ; dès lors, ils misaient assurément davantage sur la Providence que sur la médecine. N'oublions pas que le roi et ses contemporains, s'ils sont désormais des personnages de papier reconstitués par les historiens, furent des être de chair, mais aussi de foi, puisque faute de recours médical efficace, tout était finalement dans la main de Dieu » (page 79).
L'enjeu de la période c'est le dernier combat du roi Louis XIII pour organiser la régence après sa mort qu'il devine de plus en plus proche : « Ce qui est exceptionnel en ce mois d'avril 1643, c'est la volonté du roi de fixer de manière intangible la composition du ce Conseil de régence et de soumettre toute décision importante à l'aval de la majorité de ses membres. En apparence, c'est un recul de l'absolutisme, le retour à une tradition de gouvernement collectif qui met fin à la domination d'un seul. Mais en réalité, ce système collégial verrouillé est une initiative révolutionnaire, puisqu'il consacre la soumission des princes aux ministres, aux professionnels de la politique ; autrement dit, il oblige le sang à s'incliner devant la compétence » (page 174).
Comme le titre d'un chapitre l'explique, l'autre préoccupation de Louis XIII est de bien mourir pour vivre éternellement : « Affranchi des intrigues, le roi de gloire peut désormais céder la place au simple chrétien ; l'homme Louis peut enfin jeter le masque que sa naissance lui a imposé et, au soir de sa vie, révéler sa vérité. Il n'a plus qu'un rôle à jouer, le meilleur et le plus authentique : se réconcilier avec les hommes et se préparer à comparaître devant Dieu. ( ) On sait qu'un roi à le privilège de mourir deux fois, comme roi d'abord, puis comme individu ; et, même dans cette seconde mort de particulier, il lui faut échapper à l'aune commune ; comme simple chrétien, il se doit encore d'être extra-ordinaire » (page 195-196).
Dans ses derniers jours, le roi parvient à rallier la reine à ses vues et à préparer la régence sous la forme de lunion entre Anne d'Autriche et Mazarin, scellée autour de la personne du petit roi (le fils de la première et le filleul du second). On découvre dans cette dernière uvre politique la grandeur trop souvent oubliée de Louis XIII : « Etre roi de France, qui peut aujourdhui comprendre ce qui fit le drame et la grandeur dune homme simple et pieux transmué en roi par la grâce de Dieu ? Qui aujourdhui pourrait percevoir, même un instant, le poids de cet infini surmoi ? Et pourtant il y a là une clé de lecture et la personnalité du roi et de la période : lemprise religieuse et cléricale constitue assurément une des leçons que nous pouvons tirer du règne du très chrétien Louis XIII. On a vu Mazarin et le père Dinet présider aux derniers instants de celui qui se voulait fils exemplaire de lEglise catholique. Quant à Richelieu, aurait-il tenu le pouvoir, aurait-il exercé le même ascendant sur Louis XIII, sil navait été prélat ? » (page 294).
Le semestre en question dans le livre s'est finalement déroulé sans aucune violence grave et a été consacré au problème crucial de la régence et à la transmission sans incident de la couronne à son héritier légitime et à la politique visant à affirmer son pouvoir. L'auteur peut conclure que « le plan de Louis XIII a réussi, mais avec son fils, la perspective est renversée : tout à trac, Louis XIV met lEtat au service de sa gloire personnelle, là où son père, assisté de Richelieu se disait « obligé » de son état » (page 302). Un très beau livre, au texte aussi précis dans ses explications et leur documentation (voir les très riches annexes) que touchant de par sa proximité avec le sujet, notamment le quotidien de la longue agonie du roi.
F.B.
Florence Hildesheimer, La double mort du roi Louis XIII, Flammarion Champs Histoire (2011), 422 pages
L'assassinat de Charles le Bon comte de Flandre, 2 mars 1127, de Laurent Geller

Puisant ses informations dans les travaux d'un contemporain des événements, Galbert de Bruges, l'auteur utilise à merveille cette source très précise d'informations pour organiser son récit des faits - avant, pendant et après l'assassinat de Charles le Bon - qui nous sont rapportés de manière introspective. Le travail de Laurent Feller s'appuie sur les compilations de notes de première main de Galbert, avant que ce dernier ne réarrange le récit, dans le cadre d'une uvre partisane ou hagiographique, en l'honneur du comte assassiné. Elles sont ainsi d'autant plus objectives.
Lauteur plante tout d'abord le décor, en décrivant le comté de Flandre, au début du XIIe siècle, puis en en dressant le portrait de Charles le Bon. Il dissèque ensuite les motivations et laccomplissement dun complot, conduit par la famille Erembald qui fait partie de lentourage immédiat du comte. L'assassinat a lieu le 2 mars 1127, dans léglise Saint Donatien de Bruges. Il constitue une absolue transgression des règles féodales et provoque évidemment des réactions de toutes parts, depuis la bourgeoisie et la noblesse locale, jusqu'au roi de France Louis VI, qui est le suzerain du comte de Flandre. La disparition de Charles le Bon suscite également les appétits et une lutte plus ou moins ouverte entre les candidats à la succession. Les opérations de vengeance qui suivent l'assassinat sont particulièrement intéressantes à suivre, d'autant que l'auteur nous permet de suivre destin et les stratégies de chacun des conspirateurs pour survivre socialement - et survivre tout court - à l'accomplissement du complot.
Les conséquences de ce crime et du son règlement dynastique ultérieur par Louis VI témoignent finalement dune « transformation profonde du rapport existant, à lintérieur de la société flamande, entre les villes et le pouvoir princier. Un équilibre est réalisé qui permet le développement des autonomies urbaines et lexercice du pouvoir politique par laristocratie féodale ». On voit bien ici limportance de lévénement, exploré avec un grand talent par Laurent Feller.
F.B.
Laurent Feller, L'assassinat de Charles le Bon comte de Flandre, 2 mars 1127, Perrin (2012), 322 pages
La Russie contre Napoléon, la bataille pour l'Europe (1807-1814), de Dominic Lieven
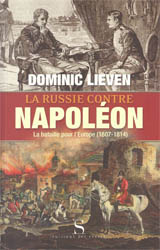
Le livre de l'historien anglais d'origine russe Dominic Lieven répond à un double objectif. L'auteur nous propose en effet une analyse thématique de haut vol du rôle éminent joué par la Russie comme « grande puissance » dans sa lutte contre Napoléon, mais il en profite pour nous offrir également un récit chronologique, épique et enlevé, des événements militaires et diplomatiques des années 1807 à 1814, c'est-à-dire de l'alliance franco-russe à Tilsit à la chute de l'Empire français, en s'attardant bien entendu plus longuement sur la dramatique campagne de Russie de 1812.
Partant du constat que les sources russes ont systématiquement été sous exploitées par les historiens aux profits des sources françaises, prussiennes ou autrichiennes, l'auteur se propose de nous en faire profiter. Tout au long de son ouvrage, Dominic Lieven s'attache à démontrer que « la politique russe de ces années-là fut intelligemment conçue et appliquée d'une manière cohérente, très loin en fait de la mythologie tolstoïenne » (page 40). Les magnifiques pages de son chef d'uvre « Guerre et paix » tendent en effet à démontrer que ce sont la neige et la chance qui ont vaincu Napoléon. Pour Lieven, au contraire, la stratégie russe n'a pas été dictée par le hasard des circonstances ou les contraintes du climat. Elle a également été décisive sur le sort de l'Europe : « Le rôle de la Russie reste peu étudié dans la compréhension de l'ère napoléonienne par le monde occidental contemporain. L'objet du présent ouvrage est de combler cette lacune. Une compréhension réaliste et structurée de la politique et de la puissance russe peut également modifier la vision globale de la période napoléonienne » (page 42).
Dans une première partie l'auteur analyse la politique de la Russie jusqu'à Tilsit, en expliquant le pourquoi et le comment de son entrée en guerre contre la France, malgré une forte animosité envers l'Angleterre. Sur le Traité de Tilsit en lui-même, Lieven met l'accent sur le fait qu'Alexandre a sauvé la Prusse d'un démantèlement pur et simple, au prix d'énormes concessions faîtes à Napoléon. Le tsar ne tirera les bénéfices de ce choix qu'en 1813. Vient donc le temps de l'alliance avec la France (1807-1812). L'auteur cite Roumiantsev qui se félicite du Blocus Continental organisé par Napoléon : « Il vaudrait mieux interrompre complètement le commerce international pendant 10 ans plutôt que de l'abandonner définitivement au contrôle de l'Angleterre » (page 89). La Russie malgré sa défiance vis à vis de l'Empire français a également peur de subir le sort de l'Inde, dominion commercial du Royaume-Uni. C'est évidemment la question de la Pologne qui complique profondément l'équation diplomatique entre Alexandre et Napoléon. Les préparatifs de guerre contre la France, dès que celle-ci redevient inévitable sont abordées en détail, notamment au travers des réformes efficaces des ministres de la guerre successifs du tsar : Araktcheïev et Barclay de Tolly.
Le cur de l'ouvrage est constitué par la grande fresque militaire qui débute avec la campagne de Russie et s'achève par l'entrée du tsar et de ses alliés à Paris. Lieven, tout en prenant un point de vue russe (il parle de retraite lors de l'offensive française vers Moscou puis de contre-offensive lors de la fameuse retraire de Russie de la Grande Armée) se révèle toujours lucide et impartial envers les autres puissances : « les plus grands rivaux de Napoléon, la Russie et la Grande-Bretagne n'étaient pas des démocraties éprises de paix, mais des empires expansionnistes et prédateurs. Un grand nombre de critiques visant la politique de Napoléon pourraient s'appliquer à l'expansion de la Grande-Bretagne en Inde pendant cette période ( ) Un projet impérial soutenu par une idéologie totalitaire et universaliste aurait eu quelques chances de réussir en Europe pendant un certain temps. Mais Napoléon n'était pas un dirigeant totalitaire, et son empire ne s'inspirait pas d'une idéologie. Au contraire, il avait mis la Révolution française sous le boisseau et fait de son mieux pour bannir l'idéologie de la vie politique française ( ) En 1812 son empire dépendait encore beaucoup de son charisme personnel » (pages 113 et 114). Au fil de son récit des événements militaires, Lieven dresse également une série de portraits hauts en couleur de nombreux protagonistes. Il vante par exemple la valeur inestimable des chefs d'état-major au service de la Russie : von Toll et Ermolov. Les qualités de l'armée d'Alexandre son aussi bien mises en évidence : le rôle décisif de sa cavalerie légère lors de la campagne de 1812, le fait qu'en 1813 les Russes sont les seuls en Europe à disposer d'une infanterie forte de nombreux vétérans aguerris, ou enfin le caractère admirable de lartillerie russe en 1814. L'auteur s'oppose ainsi à nouveau à la vision de Tolstoï qui arrête son roman à Vilna et passe sous silence les exploits russes de 1813-1814. Son récit des épisodes de cette longue guerre de deux ans est puissant et évocateur car il en intègre les dimensions, tactiques, opératives, stratégiques mais aussi psychologiques, pour conclure « quune des raisons majeures de la défaite de Napoléon par la Russie est que ses responsables furent plus perspicaces que lui » (page 489).
Reprenant les propos de Sir Charles Stewart, Dominic Lieven, affirme que « ce serait une injustice de ne pas reconnaître en Alexandre lhomme qui avait conduit les alliés à la victoire et qui par conséquent, méritait largement dêtre qualifié de libérateur de lEurope » (page 349). Lauteur parvient, au terme dun ouvrage magistral, à nous convaincre de trouver exemplaire « lhistoire dune armée russe traversant toute lEurope en 1812-1813 et accueillie dans la plupart de pays du continent comme une armée de libération » (page 491).
Le livre contient en annexe lordre de bataille détaillé de larmée russe en 1812 et celui des armées coalisées en 1813.
F.B.
Dominic Lieven, La Russie contre Napoléon, la bataille pour l'Europe (1807-1814), Editions des Syrte (2012), 612 pages
A la recherche du temps sacré, Jacques de Voragine et la Légende dorée, de Jacques Le Goff
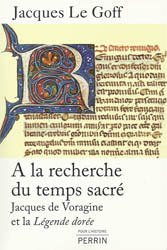
Jacques Le Goff, avec son essai intitulé « A la recherche du temps sacré » effectue le précieux travail dexpliquer aux lecteurs du XXIe siècle la richesse et limportance de luvre de Jacques de Voragine. Ce dernier, frère dominicain puis archevêque de sa bonne ville de Gênes, a marqué de son empreinte le XIIIe siècle. Son chef d'uvre, « La Légende dorée », a en effet été, après la Bible, le livre le plus lu du moyen âge et celui qui a donné lieu au plus grand nombre de copies manuscrites. Le Goff démontre aux contemporains d'une époque que lon qualifie souvent de « désenchantée » comment Jacques de Voragine, en son temps, a influé sur lorganisation et la sacralisation du temps - et plus prosaïquement du calendrier- dans une Europe occidentale ou fleurissait alors un Christianisme à son apogée. Le Goff analyse et explique, de manière toujours très intelligible, combien « La légende dorée » dépasse en cela la simple collection d'hagiographies édifiantes pour constituer une uvre majeure de la civilisation occidentale.
La sacralisation du temps que développe Jacques de Voragine s'appuie sur une distinction entre le temporal, temps liturgique, et le sanctoral, le temps des saints, en écho au dialogue que Voragine établit entre le temps des hommes et le temps divin. Le Goff parvient à nous faire découvrir avec précision le soin et la cohérence du travail de Jacques de Voragine. Son uvre aboutit à la définition d'un temps de légarement (dAdam à Moïse - dans l'Eglise, de la Septuagésime à Pâques), d'un temps de la rénovation (de Moïse à la Nativité - Avent et Noël liturgiques), d'un temps de la réconciliation (vie terrestre du Christ - de Pâques à la Pentecôte dans l'Eglise) et enfin le temps de la pérégrination (le temps actuel au cours duquel nous sommes en errance et en lutte - de l'Octave de Pentecôte et lAvent dans l'année liturgique).

En parallèle, Le Goff étudie les plus marquantes des 153 vies de saints rédigées par Jacques de Voragine pour illustrer son propos et pour démonter les talents d'écrivain d'un auteur qui sait ménager ses effets grâce à un style particulièrement flamboyant et lumineux. Une nouvelle preuve s'il en était besoin que le Moyen Âge n'as pas été l'âge sombre que l'on fait trop souvent de lui. A lire absolument, tout comme l'excellente édition intégrale de « La Légende dorée » dans la collection La Pléiade.
F.B.
Jacques Le Goff, A la recherche du temps sacré : Jacques de Voragine et la Légende dorée, Perrin (2011), 280 pages
Jacques de Voragine, La Légende dorée, Gallimard La Pléiade (2004), 1550 pages
Alexandre Ier, de Marie-Pierre Rey

La biographie d'Alexandre Ier signée Marie-Pierre Rey est une ouvre salutaire, car elle permet enfin de faire connaître en France le personnage complexe du Tsar russe qui fut l'adversaire de Napoléon. A St Hélène, l'Empereur dira d'ailleurs de lui : « Pour l'empereur de Russie, c'est un homme infiniment supérieur à tout cela : il a de l'esprit, de la grâce, de l'instruction ; est facilement séduisant ; mais on doit s'en méfier ; il est sans franchise ; c'est un vrai Grec du Bas-Empire (...) Peut-être aussi me mystifiait-il ; car il est fin, faux, adroit : il peut aller loin. Si je meurs ici, ce sera mon véritable héritier en Europe ».
C'est bien entendu avec les épreuves, au premier rang desquelles celle de 1812 que la grandeur di personnage se révèle. Marie-Pierre Rey développe sa thèse d'un tsar transformé par les épreuves terribles de cette guerre. Le jeune idéaliste, à tendances libérales et pacifistes, élève du jacobin La Harpe, se transforme radicalement : « Après l'incendie de la ville sacrée (ndlr: Moscou), sa conscience de plus en plus aiguë que la fin du monde est possible le rapproche de l'Apocalypse, texte qu'il admire, ainsi qu'il le confie à Golytsine : "Là mon cher frère, il n'y a que plaies et bosses". Dès lors, c'est dans les livres de piété et dans la Bible, devenue son ouvrage préféré, qu'il médite Il prie et se recueille, y puisant la sérénité et la paix que la situation politique lui refuse. A la fin de l'année 1812, alors que Napoléon a quitté le territoire russe, c'est un Alexandre Ier profondément transformé qui surgit des cendres et des décombres laissés par la Grande Armée. Et c'est animé de cette foi sincère, mais encore floue, qu'il va conduire ses armées jusqu'à Paris, avec le dessein de faire du continent européen un lieu de paix et de fraternité. » (page 329).
On verra d'ailleurs ensuite très bien que dès que la Coalition flanchera ou doutera (après Bautzen, après Dresde, après Montmirail) que c'est Alexandre qui trouvera les ressources et la volonté de ne jamais se détourner de sa "quête" et d'arriver jusqu'à Paris. Marie-Pierre Rey met également en avant son désaccord avec l'historiographie russe (soviétique) sur Alexandre : « Là encore, le principe d'équilibre est essentiel dans la pensée d'Alexandre. Ce point - sur lequel l'on reviendra plus loin - revêt une très grande importance et va à l'encontre d'une historiographie soviétique qui voit dans la campagne de 1813-1814 menée par Alexandre l'expression de sa prétendue volonté de rétablir une monarchie conservatrice en France. En réalité, cette interprétation plaque sur 1813-1814 un regard anachronique, soutenu par l'évolution qui caractérisera la diplomatie russe après 1818, mais elle ne saurait rendre compte des objectifs poursuivis par le tsar en 1813-1814 : à cette date, ce qui lui importe avant tout, c'est de mettre en place en France un régime politique qui réponde aux vux des Français, qui rende compte de leur histoire et de leur mémoire collective et qui, par sa stabilité et sa modération, garantisse la paix à l'Europe » (page 344). L'auteur insiste aussi beaucoup sur le rôle favorable d'Alexandre face à la France, face aux appétits des Coalisés et surtout des Prussiens lors des négociations de 1814 et encore plus en 1815.
Sinon, ont peut citer deux bons mots d'Alexandre, mentionnés dans le livre, qui éclairent aussi sa personnalité : « Aux royalistes français qui lui proposent de débaptiser le pont d'Austerlitz, il répond élégamment qu'il « suffit que l'on sache que l'empereur Alexandre y a passé avec ses armées. Visitant le palais des Tuileries, il s'arrête au salon de la paix et demande avec humour à ses guides à quoi cette pièce servait à Buonaparte ».
L'ouvrage s'achève sur les tentatives plus ou moins secrètes d'Alexandre de réunir les églises d'Orient et d'Occident et sur sa possible « fausse mort » (abdication déguisé puis vie en ermite par la suite). L'auteur ne prend pas vraiment partie mais expose avec une grande clarté tous les éléments à charges et à décharge rassemblés jusqu'alors. C'est là une histoire très étrange et assez fascinante qui conclue un livre particulièrement bien écrit.
F.B.
Marie-Pierre Rey, Alexandre Ier, Flammarion (2009), 592 pages
Philippe II, roi de Macédoine, de Ian Worthington
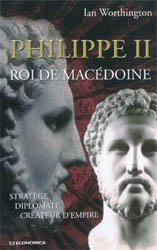
L'ouvrage de Ian Worthington peut tout d'abord être considéré comme un événement tant la publication en français (traduit de langlais) dune biographie entièrement consacrée au père dAlexandre le Grand est rare. Worthington, spécialiste de la Macédoine, nous offre ici le résultat de ses travaux sur Philippe II, dont il met en lumière les talents hors norme de diplomate, de réformateur militaire et de créateur dempire.
Cest en unifiant politiquement Haute et Basse Macédoine autour de sa personne et en dotant son royaume dune armée équipée de la très longue sarisse en bois de cornouiller, que le roi parvient à arracher à Athènes lhégémonie sur le monde Grec et poser les bases de la conquête de lAsie. La guerre dAmphipolis, celle de Thrace, les différentes Guerres Sacrées et la bataille de Chéronée bénéficient chacune dun chapitre très complet.
Le livre analyse en détails toutes les étapes de la vie de Philippe II, né en 382 av. J.-C. et devenu roi en 359, jusquà son assassinat en 336, pour démontrer limportance décisive de lhéritage quil lègue à son fils Alexandre. Illustré de 24 photos et de plusieurs schémas, le livre de Worthington constitue une nouvelle référence sur son sujet. Les annexes consacrées à l'origine ethnique du peuple macédonien ou aux dernières découvertes archéologiques (tombes royales de Vergina) constituent par ailleurs un complément passionnant au corps de l'ouvrage.
F.B.
Ian Worthington, Philippe II, roi de Macédoine, Economica (2011), 320 pages
Lart français de la guerre, dAlexis Jenni
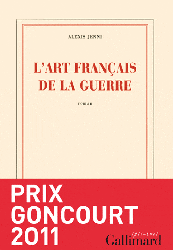
Le livre dAlexis Jenni, lauréat du prix Goncourt, se présente à la fois comme un récit initiatique et comme une méditation sur la France : en échange de cours de peinture, le jeune narrateur du roman pose ses mots sur lhistoire de Victorien Salagnon, soldat de toutes les guerres menées par la France, de 1942 à 1962. Salagnon na justement sauvé son âme quen peignant tout ce quil voyait, de la Résistance aux guerres de la décolonisation : ses dessins lui ont offert le recul qui lui a épargné la colère qui hantera pour toujours son compagnon darme Mariani. Mais peindre ne suffit pas. Il faut des mots pour dire les choses, car aujourdhui comme hier, « on meurt d'engorgement, on meurt d'obstruction, on meurt d'un silence vacarmineux tout habité de gargouillements et de fureurs rentrés. Ce sang trop épais ne bouge plus. La France est précisément cette façon de mourir » (page 198).
Cest bien des mots, de la langue et du traitement romanesque de l'histoire quil est question dans « Lart français de la guerre ». Comme lexplique le narrateur, la guerre est surtout affaire de mots : « César par le verbe créait la fiction d'une Gaule, qu'il définissait et conquérait d'une même phrase, du même geste. César mentait comme mentent les historiens, décrivant par choix la réalité qui leur semble la meilleure. Et ainsi le roman, le héros qui ment fondent la réalité bien mieux que les actes, le gros mensonge offre un fondement aux actes, constitue tout à la fois les fondations cachées et le toit protecteur des actions. Actes et paroles ensemble découpent le monde et lui donnent sa forme. Le héros militaire se doit d'être un romancier, un gros menteur, un inventeur de verbe. » (page 59).
Partant de ce constat, et presque naturellement, lhistoire de la « guerre de vingt ans », vécue et dessinée par Salagnon, prend alors toute sa puissance dans les mots avec lesquels le narrateur parvient à la traduire. Le livre d'Alexis Jenni s'inscrit alors comme une parabole de « LOdyssée ». Ce livre est présent en arrière fond des réflexions du narrateur tout autant qu'il accompagne Salagnon et ses compagnons d'armes. L'Odyssée est par exemple le seul livre lu par l'oncle de Salagnon, son mentor dans la vie militaire, au point quil passera sa vie, comme les anciens grecs, à lapprendre par cur. La comparaison entre le voyage d'Ulysse est les aventures de Salagnon est ouvertement assumée : « Ulysse est allé au pays des morts pour demander à Tirésias le devin comment ça finira. Il offre un sacrifice aux morts et Tirésias vient, avide de boire. "Allons ! Écarte-toi de la fosse ! Détourne toi de ton glaive : que je boive le sang et te dise le vrai !". Ensuite, il lui explique comment cela finira : dix ans de guerre, dix ans d'aventures violentes pour rentrer, où ses compagnons mourront sans gloire un par un, et un massacre pour finir. Vingt ans d'un carnage auquel seul Ulysse seul survivra » (page 526). Contre point intéressant Salagnon, de son côté, se plonge un moment dans « LIliade ».
Si lhistoire du soldat, du lieutenant puis du capitaine Salagon, dont la réputation établie est celle d'un homme qui, quelques soient les circonstances, survit et ne « meurt jamais », prend les accents de celle dUlysse, il lui faut comme à la France un Homère. De Gaulle, que le narrateur - tout à son mal être initial et perdu dans une France dans laquelle il ne sait plus qui il est - se plait à qualifier du nom finalement admiratif du « Romancier » est évidemment celui-là : « Je pense à la France ; mais qui peut dire sans rire, qui peut dire sans faire rire, qu'il pense à la France ? Sinon les grands hommes, et seulement dans leurs mémoires. Qui sinon de Gaulle, peut dire sans rire qu'il pense à la France ? Moi j'ai juste mal et je dois parler en marchant jusqu'à ce que j'atteigne la pharmacie de nuit qui me sauvera. Alors je parle de la France comme de Gaulle en parlait, en mélangeant les personnes, en mélangeant les temps, confusant la grammaire pour brouiller les pistes. De Gaulle est le plus grand menteur de tous les temps, mais menteur il l'était comme les romanciers. Il construisit par la force de son verbe, pièce à pièce, tout ce dont nous avions besoin pour habiter le XXe siècle. Il nous donna, parce qu'il les inventa, les raisons de vivre ensemble et d'être fiers de nous. Et nous vivons dans les ruines de ce qu'il construisit, dans les pages déchirées de ce roman qu'il écrivit, que nous prîmes pour une encyclopédie, que nous prîmes pour l'image claire de la réalité alors qu'il ne s'agissait que d'une invention ; une invention en laquelle il était doux de croire » (pages 160-161).
La suite, les caractéristiques de « l'art français de la guerre », ses conséquences sur la France dhier et daujourdhui, le narrateur va les comprendre en écoutant Salagnon lui raconter sa vie. Il remonte ainsi les fils complexes de lhistoire, de létat guerrier et de son absurdité et de ce qu'il désigne comme la « pourriture coloniale » qui est venue dénaturer les combats et la langue de la France. Les interrogations sont multiples, mais cest leur filiation historique quanalyse le mieux le livre dAlexis Jenni : « Le corps social est malade. Alité, il grelotte. Il ne veut plus rien entendre. Il garde le lit, rideaux tirés. Il ne veut plus rien savoir de sa totalité. Je sais bien qu'une métaphore organique se la société est une métaphore fasciste ; mais les problèmes que nous avons peuvent se décrire d'une manière fasciste. Nous avons des problèmes d'ordre de sang, de sol, des problèmes de violence, des problèmes de puissance et d'usage de la force. Ces mots-là viennent à l'esprit, quel que soit leur sens » (page 169) ; ou encore « Je parle encore de la France en marchant dans la rue. Cette activité serait risible si la France n'était justement une façon de parler. La France est l'usage du français. La langue est la nature où nous grandissons ; elle est le sang que l'on transmet et qui nous nourrit. Nous baignons dans la langue et quelqu'un a chié dedans. Nous n'osons plus ouvrir la bouche de peur d'avaler un de ces étrons de verbe. Nous nous taisons. Nous ne vivons plus. La langue est pur mouvement, comme le sang. Quand la langue s'immobilise, comme le sang, elle coagule. Elle devient petits caillots noirs qui se coincent dans la gorge. Etouffent. On se tait, on ne vit plus. On rêve d'utiliser d'anglais, qui ne nous concerne pas » (page 197-198).
Sur le fond, la Résistance et la fin de la seconde guerre mondiale, au cours de laquelle Salagnon fait ses premières armes, ont permis à la France de retrouver la « force » et de nouveau pouvoir en faire usage. Et puis il y a le Tonkin : « On avait jeté sur l'Indochine une étrange armée, qui avait pour seule mission de se débrouiller. Une armée disparate commandé par des aristocrates d'antan et des résistants égarés, une armée faite de débris de plusieurs nations d'Europe, faite de jeunes gens romantique et bien instruits, d'un ramassis de zéros, de crétins, et de salauds, avec beaucoup de types normaux qui se retrouvaient dans une situation si anormales qu'ils devenaient alors ce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de devenir. Et tous posaient pour la photo, autour de la machine, et souriaient au photographe. Ils étaient l'armée hétéroclite, l'armée de Darius, l'armée de l'Empire » (pages 453-454). Le regard porté sur la réalité de lempire colonial français nest pas celui de la repentance ou de la nostalgie. Une fois encore les mots du narrateur sont là pour permettre de poser clairement les enjeux, annonciateurs de ceux qui surgiront dans lAlgérie, qui se rêve totalement française : « Les empires ont du bon, colonel, il vous foute la paix, et vous pouvez toujours en être. Vous pouvez être sujet de l'empire à peu de conditions : juste accepter de l'être. Et vous garderez vos origines, même les plus contradictoires, sans qu'elles vous martyrisent. L'empire permet de respirer en paix, d'être semblable et différent en même temps, sans que cela soit un drame. Par contre, être citoyen d'une nation, cela se mérite, par naissance, par la nature de son être, par une analyse pointilleuse des origines. C'est le mauvais aspect de la nation : on en est, ou on en n'est pas, et le soupçon court toujours » (pages 228-229). Son regard sur les ennemis que l'ont a combattu, de lAllemagne nazie au Viêt Minh est-lui aussi clair et net : « Ils m'effraient ces types, parce qu'ils préfèrent montrer du rouge vif plutôt que de sauver leur peau en se cachant. Ils n'étaient plus que la hampe qui tient le drapeau, et ils sont morts. C'est ça, l'horreur des systèmes, le fascisme, le communisme : la disparition de l'homme. Ils n'ont que ça à la bouche : l'homme, mais ils s'en foutent de l'homme. Ils vénèrent l'homme mort » (page 288).
Si en Indochine, lOdyssée de Salagnon et de ses compagnons continue « Voilà écoute encore "Et, deux jours et deux nuits, nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin." Homère parle de nous, bien plus que les actualités filmées. Au cinéma ils me font rire, ces petits films pompeux : ils ne montrent rien ; ce que raconte le vieux Grec est bien plus proche de l'Indochine que je parcours depuis des mois » (pages 294-295), les choses vont forcément prendre une autre tournure en Algérie. Là se construit la frontière silencieuse entre « eux » et « nous », sans autre forme de procès : « La pourriture coloniale nous rongeait. Nous nous sommes tous comporté de façon inhumaine car la situation était impossible. ( ) Et pourtant nous avons retrouvé la force dont nous avions manqué ; mais nous l'avons appliqué ensuite à des causes confuses, et finalement ignobles. Nous avions la force, nous l'avons perdue, nous ne savons pas exactement où. Le pays nous en garde rancune, cette guerre de vingt ans n'a fait que des perdants, qui s'invectivent à voix basse d'un ton fielleux. Nous ne savons plus qui nous sommes » (page 601). Il faut de Gaulle, une nouvelle fois, pour mettre les mots quil faut sur ces dévoiements : « On peut gloser sur de Gaulle, on peut débattre de ses talents d'écrivain, s'étonner de ses capacités de mentir-vrai quand il travestit ce qui gêne et passe sous silence ce qui dérange ; on peut sourire quand il compose avec l'Histoire au nom des valeurs les plus hautes, au nom de valeurs romanesques, au nom de la construction des ses personnages, lui-même en premier lieu, on peut ; mais il écrit. Son invention permettait de vivre. Nous pouvions être fiers d'être de ses personnages, il nous a composés dans ce but, être fiers d'avoir vécu ce qu'il a dit, même si nous soupçonnions qu'au-delà des pages qu'il nous assignait existait un autre monde. Il faut réécrire maintenant, il faut agrandir le passé » (page 604-605). Grâce au travail nécessaire et salvateur de transmission, effectuée entre Salagnon et le narrateur, ce dernier devient progressivement capable d'une grande lucidité sur le monde qui est le sien, ce qui lui permet par exemple de faire le tri entre les vertus paradoxales des mots du « Romancier » et les mensonges scénarisés du film « La Bataille d'Alger », de Gillo Pontecorvo. Il fait d'ailleurs une critique acerbe et à contre courant de ce « film officiel des accords d'Evian », en racontant les impressions qui sont les siennes après l'avoir vu : « Nous vîmes cette légende de gauche ce film interdit longtemps, scénarisé par le chef de la zone autonome d'Alger, qui jouait son propre rôle. Je le vis et je fus étonné que l'on ait cru devoir l'interdire ( ). J'ai bien compris ce film. Personne n'est mauvais, il est juste un sens à l'Histoire auquel on ne s'oppose pas. Je ne comprenais pas que l'on ait cru devoir l'interdire. Ce fut tellement plus sordide ( ) Pontecorvo était à Alger en 1965, cinéaste officiel du coup d'Etat. Il était un sale type, les cinéphiles le savaient. ( ) Les gens quittaient la salle d'un air pénétré, ils avaient le sentiment d'avoir vu un film interdit, qui disait le vrai puisqu'on avait tenté de le cacher. Personne sans doute dans cette salle ne voyait le mensonge sur l'écran, car personne sans doute ne connaissait les chars » (page 586 et suivantes).
Au bout de 600 pages du livre d'Alexis Jenni, on finit par bien comprendre comment tant d'hommes se sont perdus dans la pratique de l'art de la guerre, devenu leur seul quotidien. On comprend les motivations d'hommes aussi différents que Salagnon ou Mariani, unis pour toujours simplement parce qu'ils sont revenus vivant de cette odyssée, on comprend aussi pourquoi autant d'entre eux se sont portés volontaires, avec une bravoure déraisonnable, pour aller jusqu'à la dernière minute mourir à Dien Bien Phu : « Il ne nous restait plus grand chose après des années de guerre, que ça : dans ce pays-là nous avions perdu toutes les qualités humaines, il ne nous restait plus rien de lintelligence et de la compassion, il nous restait que la furia francese, poussée à bout » (page 627). La volonté d'en finir, de sauver son honneur. On comprend également, in fine, le développement suggéré sur les récentes émeutes de banlieue comme héritage de cette fameuse guerre de vingt ans. Avec un regard discret mais aiguisé sur la question de la religion - « L'Eglise mange mal, s'exclama Montebellet, mais elle a toujours eu du bon vin. - C'est pour cela qu'on lui pardonne, à cette vénérable institution. Elle a beaucoup péché, beaucoup failli, mais sait donner l'ivresse » (page 298) Jenni nous offre un texte lucide, particulièrement bien écrit et habilement composé sur l'état de la France : « Personne ne s'occupe de personne, Salagnon. La France disparaît parce qu'elle est devenue une collection de problèmes personnels. Nous crevons de ne pas être ensemble. Voilà ce qu'il nous faudrait : être fier d'être ensemble » (page 106). Si l'identité ne peut pas et ne dois pas s'écrire, « L'art français de la guerre » nous démontre que l'histoire, elle, doit impérativement l'être, avec ambition et ouverture, comme un roman qui redéfinira les contours de notre avenir : vérité romanesque, aux accents girardiens, éloge de la transmission et de la narration, avec des mots et une langue qui finalement nous définissent mieux que tout autre chose.
F.B.
Alexis Jenni, Lart français de la guerre, Gallimard (1989), 633 pages
Comment sortir de la Terreur ? Thermidor et la Révolution, de Bronislaw Baczko

Le livre de Bronislaw Baczko - « Comment sortir de la Terreur ? Thermidor et la Révolution » - publié pour la première fois en 1989, s'ouvre sur une interrogation : « Comment la Révolution de l'An II a-t-elle pu s'engager dans la Terreur et s'effondrer en une seule journée (le 9 Thermidor) au cours de laquelle deux coups de feu seulement de feu furent tirés ? ». L'ouvrage s'attache à décrypter les mythes qui ont précédé, accompagné et provoqué ce soubresaut majeur de la Révolution. Le dossier sur la Terreur n'est jamais traité « à charge », l'auteur prenant à chaque fois le recul nécessaire pour expliquer ce que cache chaque mot ou chaque événement. Le livre de Baczko est réellement passionnant, dans son analyse des mécanismes (il s'agit bien de cela) qui président aux constructions puis aux retournements idéologiques de l'An II. Il n'est pas question de ne parler que des « dossiers noirs de la Révolution » mais de comprendre les enjeux idéologiques et de leurs conséquences. Le travail de Baczko est en cela fascinant, car toute les manipulations de l'opinion sont décortiquées et expliquées.
Le premier chapitre est consacré à la rumeur lancée contre Robespierre à la veille du 9 Thermidor : l'Incorruptible aurait voulu devenir roi et épouser la fille de Louis XVI. Rumeur totalement inventée, personne n'en doute, mais rumeur néanmoins très écoutée au cours de ces heures décisives. La calomnie politique est aussi ancienne que l'est la politique précise d'ailleurs l'auteur, en rappelant par exemple La Grande Peur : « La Terreur se nourrit de cet imaginaire et le produit à son tour ; elle fabrique des complots qui font confondre tous les ennemis dans la figure globale du « suspect » et s'alimente de la peur et du soupçon qu'elle secrète. L'imagination sociale façonnée par la Terreur est surexcitée et désaxée, mais elle est aussi, pour les mêmes raisons, marquée par une sorte de fatigue et d'inertie. Tout, voire n'importe quoi, n'est-il pas devenu acceptable pour elle ? » (page 45).
Baczko évoque ensuite les lignes de front de la Fin de l'An II et expose pourquoi la Terreur, comme politique devenue monstrueuse, est remise en cause et rejetée : « La Terreur menace et punit les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont fait ; du coup, en introduisant le concept de « classes suspectes », elle substitue l'arbitraire à la justice » (page 80). Ce thème est prolongé au chapitre suivant, intitulé « L'horreur à l'ordre du jour », dans lequel l'auteur analyse le retournement qui se produit, après Thermidor, sur la perception de la Terreur comme mode de gouvernement. L'élément décisif est celui du procès Carrier, le représentant en mission de la Convention à Nantes. Alors que quelques centaines de prisonniers (ceux qu'il n'avaient pas fait exécuter) sont libérés des prisons parisiennes où ils avaient finit par atterrir, Carrier va lui marcher droit à la guillotine : « Les récits sur la perversité de Carrier, dans l'imaginaire collectif, ont pour fonction précise de camper son image de monstre. Carrier cristallise en soi les « grandes mesures » et la Terreur au quotidien » (page 227). Tout le monde a entendu parler de ses « noyades », de ses « mariages républicains » voire de ses « orgies », dont l'auteur démontre qu'ils ont sans doute été aussi réels sous la Terreur qu'exagérés ensuite par la réaction thermidorienne. De son côté, Carrier organise sa défense sur le thème des « circonstances exceptionnelles », justifiant les moyens par leur fin et présentant la Terreur comme une simple conséquence de la menace contre-révolutionnaire (notamment la guerre de Vendée) : « La République doit donc assumer la responsabilité de ses actes et leurs conséquences. En persécutant ceux qui ont exécuté ses ordres, la Convention se fait un procès à elle-même » (page 237). Il ne coupera pourtant pas à l'échafaud (où il mourra même avec une certaine noblesse), car « Le monopole de la parole, détenu par les Jacobins pendant la Terreur, est définitivement brisé. (...) La parole jacobine ne représente plus l'instance idéologique, comme c'était le cas pendant la Terreur. Elle prétend toujours être légitimée par le peuple, mais cette prétention creuse est tournée en dérision » (page 244).
Ce retournement de l'opinion est ensuite amplifié par la montée en puissance des « muscadins », cette « jeunesse dorée » qui s'engouffre dans le vide laissée par l'effacement des Jacobins et de Sans-Culottes des rues de Paris. Ils règnent sur les cafés, donnent du bâton... Ils seraient 2000 à 3000 dans Paris. Le chapitre suivant porte sur « Le peuple vandale » : « Car la révolution, héritière des Lumières, n'avais pas seulement conduit à la « tyrannie » , elle avait également engendré une monstruosité qui contredisait à la fois ses origines et ses objectifs et qu'elle voulait à jamais bannir : le vandalisme » (page 254).
Enfin, le chapitre sur le « Moment thermidorien » décortique comment la Révolution a été menée à son terme, notamment par le débat sur la Constitution a adopter : « La question glissait de « comment en finir avec la Terreur ? » à « comment terminer la Révolution ? ». Les thermidoriens auraient donc à la fois à formuler leurs réponses à toutes ces préoccupations à la fois en terme de réaction à la terreur et en termes de promesses d'avenir. Il faudrait inventer une nouvelle utopie répondant au nouveau départ de la République, renouant avec ses origines et ses principes fondateurs, ses attentes et ses promesses compromises par la terreur. Penser ensemble la réaction et l'utopie, c'est également le défi que doit relever l'historien qui entend comprendre comment se clôt la période thermidorienne et sur quelles perspectives elle s'ouvre » (page 306). Alors que le « peuple » lance ses dernières forces dans les journées de Germinal et de Prairial, au cri de « Du pain et la Constitution démocratique de 1793 » et assassine le député Féraud au sein même de la Convention, cette dernière emporte facilement la partie et fait condamner les derniers Montagnards : « Laction désordonnée, brutale et inefficace de la foule a mis en évidence la fragilité du phénomène sans-culotte ainsi que son caractère conjoncturel. Celui-ci se voit de plus en plus réduit à lancien personnel politique de la Terreur, traqué partout essayant déchapper aux massacres et à la « revanche légale », tout aussi impitoyable que systématique. Léchec de la révolte parachève le 9 thermidor ; cest une victoire, sans aucune équivoque possible, de la Convention sur la rue, du « système représentatif » sur les pratique de la démocratie directe, réduite à « lanarchie » dune foule violente. Germinal et prairial présentent en quelque sorte lenvers des journées révolutionnaires. Elles annoncent le déclin, voire la fin, de limagerie héroïque et militante de lan II, celle du peuple debout prête à reprendre sa souveraineté » (page 326).
Il en découle ensuite, après que la réaction royaliste de Vendémiaire ait également été conjurée, la promulgation d'une Constitution d'inspiration censitaire : « Létablissement dun régime censitaire culturel donnait indirectement et furtivement raison à ceux qui affirmaient que la République était venue trop tôt, avant que les Lumières eussent éclairé toute la population et non seulement les élites. Le bouleversement politique aurait devancé le progrès civilisateur. (...) Les Lumières étaient à lorigine de la Révolution, cest aux Lumières quil revient de la terminer » (page 346-347). Son adoption achève définitivement l'épisode révolutionnaire.
Baczko conclue sur le mythe de « l'éternelle jeunesse révolutionnaire » : « Le moment thermidorien, cest léclatement dune évidence : la Révolution est fatiguée, la Révolution est vieillie. (...) Les révolutions vieillissent assez vite. Elles vieillissent mal, par leur obstination symbolique à toujours vouloir marquer un nouveau départ de lHistoire, être une rupture radicale dans le temps, demeurer une uvre en ses perpétuels commencements, incarner la jeunesse dun monde qui durerait toujours. La Révolution chante les lendemains, mais voudrait ne jamais quitter laujourdhui inaugural de sa venue au monde (...) La Révolution, même prise dans ses mythes, nest pas un conte. Et Thermidor est ce miroir sans magie qui renvoie à chaque révolution naissante la seule image quelle ne voudrait pas voir : celle de lusure et de la décrépitude qui tue les rêves » (page 353).
La Révolution n'a pas été tuée, étranglée, glacée alors quelle était encore « toute jeune », elle a simplement vieillie. Brillant... Limpide.
F.B.
Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur ? Thermidor et la Révolution, Gallimard (1989), 353 pages
Et Rome devint une République 509 av. J.-C, de Thierry Piel et Bernard Mineo

Les auteurs nous plongent, avec leur livre de 120 pages bien illustrées, dans les mystères de la Rome archaïque. Ils nous rapportent tout d'abord les faits tels que la tradition les a transmis jusqu'à nous : le 7e et dernier roi de Rome, le tyrannique Tarquin le Superbe, est chassé du trône par un cousin. Ce dernier l'a berné en se faisant passé jusqu'alors pour un idiot (Brutus) et a ensuite établit la République, dont il devient un des deux premiers consuls.
Dans une seconde partie Thierry Piel et Bernard Mineo évoquent les ressorts idéologiques et mythologiques utilisés par la littérature antique, notamment par Tite Live, dans l'élaboration du mythe qui entoure les événements de l'année 509 av. J.-C. : « Ce que nous appelons « histoire » dans l'Antiquité ne l'est pas au sens qu'a pris cette science humaine aujourd'hui. Ecrire l'histoire c'est avant tout écrire « des histoires » qui se doivent de joindre l'utile - surtout- à l'agréable. Or l'année 509 av. J.-C., on l'aura compris, n'est pas une année comme les autres. Pour les Romains, elle était un moment fondateur ou plutôt refondateur de l'histoire de Rome, celui de la respublica libera, garante de la grandeur à venir de l'Urbs » (page100).
Enfin, et c'est la partie la plus intéressante de l'ouvrage, les auteurs nous livrent la reconstruction historique la plus plausible des faits : « On aura compris que la révolution de 509 av. J.-C. ne peut être comprise quau travers des turbulences politico-militaires que connaissent Rome et le Latium à partir de la fin du VIe siècle av. J.-C. Au risque de forcer le trait, nous pourrions estimer que la République est née accidentellement à la suite de lintervention de Porsenna. Celle-ci fut à lorigine dune guerre opposant Rome à une coalition de Latins, au sein desquels émerge la figure de Tusculan Octavius Mamilius, soutenu par Aristodème de Cumes, lors de la bataille dAricie qui vit la défaite de Porsenna. Ce qui suit, à savoir laffrontement quasi surnaturel du lac Régille, nest là que pour forger le mythe dune Rome actrice unique de son destin, celui dune république libre incarnant le nomem latinum » (page 85). On y décèle l'importance des interventions armées de véritables « condottieres », lors des batailles du bois sacré d'Arsia et du Lac Régille, dans un contexte troublé qui voit le bouleversement des structures traditionnelles : « La révolution de 509 av. J.-C. fut sans doute la conséquence de ces crises chroniques que connaissaient alors les cités étrusco-latines. Porsenna, transfuge étrusque, originaire de la région de Clusium, en fut le principal acteur, mais sa présence à Rome ne fut pas suffisamment durable pour qu'il intègre pleinement l'histoire romaine, contrairement à Mastarna métamorphosé en Servius Tullius. Les conséquences de l'intervention armée du « condottiere » clusinien furent doubles. dans un premier temps, les Tarquins, qui dominaient la vie politique romaine depuis un siècle, furent chassés définitivement. dans un second temps, un bref conflit opposa partisans de Porsenna et partisans latins des Tarquins, les lignes de partage passant quelquefois à l'intérieur même des cités. C'est dans ce contexte troublé que le rex romain disparut et que le Sénat posa les bases d'un nouvel ordre institutionnel, qui mettra cependant un siècle et demi à se stabiliser » (page 102).
Le texte de Thierry Piel et de Bernard Mineo est précis et parvient à démêler les fils d'un monde dont finalement nous n'avions qu'une idée très parcellaire.
F.B.
Thierry Piel et Bernard Mineo, Et Rome devint une République 509 av. J.-C., Lemme Edit (2011), 120 pages
Les campagnes du Second Empire, ouvrage collectif, Bernard Giovanangeli Editeur
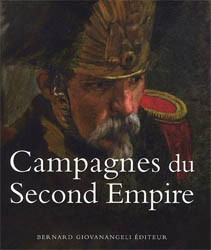
L'histoire militaire du Second Empire est trop souvent réduite au seul désastre, malheureusement bien réel, de l'été 1870. Pour autant, et ce magnifique ouvrage collectif édité par Bernard Giovanangeli Editeur s'en fait l'écho, l'armée française du Second Empire a fait bien plus pour la France. Le livre s'attache bien entendu aux grandes campagnes très connues : guerre de Crimée, guerre d'Italie, guerre du Mexique et guerre de 1870. De façon bien plus originale, il couvre également des opérations de projection de forces bien moins connue - le siège de Bomarsund (1854), les expéditions en Chine et en Syrie (1860 toutes les deux) - ainsi qu'aux opérations à vocation coloniale en Algérie, au Sénégal et en Cochinchine. La question romaine et le rôles de zouaves pontificaux est également évoqué dans le chapitre consacrée à La bataille de Mentana (1867).
L'ouvrage vaut par la qualité des ses illustrations : tableaux de maîtres, dessins en couleur et surtout photographies d'époque, rarement publiées auparavant. La « grande de stratégie » de Napoléon III, l'organisation de son armée et le rôle décisif de sa flotte (une des plus puissante de toute l'histoire de France) sont très bien expliquée dans les chapitre introductifs et conclusifs. Un très beau livre, également très utile pour replacer le Second Empire à la place qu'il mérite dans l'histoire de notre pays.
F.B.
Bernard Giovanangeli (collectif sous la direction de), Les campagnes du Second Empire, Bernard Giovanangeli Editeur (2010), 158 pages
Louis XI ou le joueur inquiet, d'Amable Sablon du Corail

Le livre d'Amable Sablon du Corail (chez Belin) renouvelle en profondeur l'approche que l'on peut avoir du fils de Charles VII, notamment par rapport à la biographie de référence de Paul Murray Kendall, excellente, mais excessivement favorable à Louis XI. L'ouvrage dépeint le parcours d'un roi, passionné par l'intrigue, la politique et la guerre, et qui a finit par obtenir les plus importants agrandissements du domaine royal depuis Philippe Auguste. L'auteur montre les particularités d'un souverain, parfois réduit à tort au seul bon diplomate qu'il était : « Au cours de la campagne de Normandie, on vit pour la première fois à l'uvre ce qui fut la grande force de Louis XI, sa spécificité et comme sa marque de fabrique, à savoir une parfaite intégration de l'action militaire et de l'action politique. On en donne parfois une analyse fautive en faisant de Louis XI un homme qui préférait la diplomatie à la guerre. Il n'en était rien. Le roi choisissait toujours la solution qui paraissait la plus efficace et la plus rapide. En excellent soldat qu'il était, il connaissait les risques de la guerre et ne recourait à la force qu'après s'être assuré de l'emporter » (page 183).
Tout en traitant du contexte général du XVème siècle et en évoquant la personnalité du roi, le très bon livre de Sablon du Corail parle en premier lieu de la volonté de puissance de Louis XI et de ses conséquences. « Il allait de soi que les princes ne disposaient pas librement de leurs corps, ils étaient mariés dès leur naissance et les mariages étaient consommés au sortir de l'enfance » ( ) « Cela ne doit pas occulter le caractère essentiellement dissuasif de la violence politique de Louis XI. Elle ne touchait qu'un très petit nombre de personnes, et peu d'entre elles perdirent leur vie ou leurs biens. Les murs s'étaient beaucoup adoucies de puis l'Empire romain et les royaumes barbares » (page 306).
La diplomatie et la guerre occupent le devant de la scène. Le fil conducteur de cette biographie est la lutte engagée par le roi de France pour prendre la mesure des ses voisins bretons, bourguignons et anglais. L'auteur parvient, au fil des chapitres et de l'évolution dans le temps des capacités et des méthodes du roi, à dégager les raisons du succès de Louis XI : « Le registre dont il jouait était d'une extrême variété. Louis XI savait instinctivement adapter son comportement aux circonstances. Il était imprévisible, non parce qu'il avait un caractère instable, mais parce qu'on ne pouvait savoir à l'avance comment il réagirait. Ses adversaires étaient tellement primaires ! Charles le Téméraire était orgueilleux et trop sûr de lui ; il fallait lui trouver des ennemis et détourner son agressivité du royaume. Edouard IV et François II étaient rusés mais indolents ; ils ne cherchaient que la paix pour leurs Etats et la sécurité pour eux-mêmes. Jean II d'Aragon les surpassait tous en cynisme et en cautèle ; le tout était de savoir le trahir le premier. Louis XI pouvait être offensif ou craintif, dissimulateur ou hésitant, audacieux ou prudent, arrogant ou humble, dissimulateur ou d'un naturel désarmant. Commynes souligne l'erreur d'appréciation la plus généralement commise par les ennemis de Louis XI : Et ils tenaient le roi pour craintif ; c'est vrai qu'il lui arrivait de l'être, mais il ne l'était jamais sans qu'il y eût une raison » (page 317).
Fait suffisamment rare dans une biographie d'un auteur français pour qu'on le signale, le livre propose un encart de huit cartes en pleines pages et en couleur, dont un schéma détaillé de la bataille de Montlhéry et deux cartes sur les différentes phases de la guerre du Bien Public. Les recherches menées par l'auteur témoignent enfin de l'activité forcenée de Louis XI qui culmine dans sa lutte à mort menée contre la Bourgogne du Téméraire.
Point capital pour comprendre Louis XI, l'auteur démontre combien, après des débuts quelques peu transgressifs, le roi qu'il est devenu s'inscrit parfaitement dans la continuité du « grand projet » capétien. A titre d'exemple : « En 1469, le pape Paul II conférait au roi de France le titre de roi très chrétien. Le glorieux superlatif, qu'on trouvait depuis longtemps sous la plume des propagandistes du roi, était désormais agréé par le souverain pontife ; il venait couronner un demi-millénaire de piété capétienne et de vertus héroïques » (page 267).
Le règne de Louis XI marque une étape supplémentaire dans l'affirmation de l'Etat royal français, dans sa montée en puissance, notamment après l'effondrement de la Bourgogne. La cohérence de l'action du roi, qui le pousse à renouer avec les fils de la politique de ses prédécesseurs et notamment celle de son père, après les avoir contesté dans sa jeunesse, est une belle preuve de son appropriation de la « mission » qui lui incombe. « Louis XI, par ses préjugés, par ses valeurs, par sa pratique du pouvoir, était d'abord un homme de son temps » (page 453).
« Louis XI ou le joueur inquiet » requiert une lecture attentive. Le style est précis, le fond est complexe et demande un effort d'attention important.
F.B.
Amable Sablon du Corail, Louis XI ou le joueur inquiet, Belin (2011), 450 pages
Aux sources de lémigration russe blanche, Gallipoli, Lemnos, Bizerte (1920-1921) de Nicolas Ross

Le point de départ de louvrage de Nicolas Ross est la genèse de lArmée des Volontaires puis le récit des campagnes dans le sud de la Russie et en Crimée, entre 1918 et 1929, pour tenter de renverser le régime révolutionnaire soviétique désormais au pouvoir à Moscou. Ces troupes, conduites notamment par Alexeïev, Denikine, Koutiepov, Drozdovski ou Markov prennent en 1920, après leur défaite, les chemins de lexil sous lautorité suprême de Wrangel. Ce dernier na de cesse de préserver leur existence en tant quarmée organisée, afin de pouvoir reprendre la lutte dès que les circonstances le permettront.
Les russes blancs quittent la Crimée par mer, pour être accueillis dans un premier temps à Istanboule. Avec le soutien constant de la France, qui rechigne pourtant parfois à la tâche, les russes blancs vont être dirigés vers plusieurs destinations où ils vont séjourner plusieurs années. Lescadre russe de la Mer Noire, aux mains des blancs, prend la direction de Bizerte, grand port du protectorat français de Tunisie. La vie quotidienne et religieuse sorganise sur place et la flotte continue à manuvrer, pour lexercice. Mais avec la reconnaissance de lURSS par les pays européens, le dernier vestige de la flotte finit par être dissout, ses navires dispersés ou envoyés à la ferraille. Jamais pourtant la France de cédera aux instances des soviétiques qui en réclament les derniers vaisseaux dans les années 30. Sur lîle grecque de Lemnos, ce sont plus de 15.000 cosaques du Kouban qui sont accueillis dans les anciennes installations des troupes alliées. Ils sont bientôt rejoints par près de 3.000 cosaques du Don. Plus quailleurs, les soldats blancs souffrent à Lemnos dun isolement qui est jugé lancinant. Mais cest sans aucun doute à Gallipoli où est installé le premier corps darmée des russes blancs, que Wrangel parvient insuffler à ses troupes les valeur qui forgeront lavenir de lémigration russe : « Cest largement à Gallipoli que se forgea quelque chose de beaucoup plus durable et de plus essentiel : lautre Russie, la Russie des Russes blancs, suffisamment forte pour surmonter toutes les pressions et toutes les tentations sans perdre foi en la résurrection future de la patrie et conserver lespoir, durant soixante-dix ans, de la fin de la dictature communiste de ce pays » (page 111). Là plus quailleurs, alors que la région est alors sous administration grecque, les Russes blancs veillent à préserver leur culture, leur vie religieuse fervente et leur motivation à lutter à lavenir pour retourner victorieux dans leur patrie. Le sport tient également une place importante à Gallipoli, par exemple à travers une ligue et un championnat de football, pour maintenir le moral des exilés.
Mais la vie dans ces trois premières installations, bien quorganisée dans la durée, nen demeure pas moins provisoire. Le Russes blancs sont bientôt accueillies par plusieurs pays. Ce sont dabord les nations slaves et orthodoxes, Serbie et Bulgarie, qui recueillent les anciens soldats de Wrangel. La Roumanie et la Grèce, orthodoxes elles aussi, et surtout la France deviennent également des lieux dexil privilégiés. Wrangel a le temps dorganiser la ROVS (Rousskïï obchteche-voïnskïï soyouz - Union générale des combattants russes), avant de mourir à Bruxelles, en 1928, probablement empoisonné par des agents soviétiques. Après le seconde guerre mondiale, la main mise soviétique sur lEurope orientale et centrale pousse encore plus les Russes blanc vers la France. Cest finalement dans le cimeterre de Sainte-Geneviève-des-Bois, non loin de Paris, quest construite en 1961 une réplique plus petite, du monument aux morts blancs de Gallipoli détruit par un tremblement de terre en 1940. Les temps changeant, le monument de Gallipoli est lui relevé en 2008, avec le soutien des autorités russes. Fidèles aux valeurs ancestrales de leurs pays, les émigrés russes blancs sont désormais parfaitement intégrés dans leurs pays daccueil et lauteur sattache à nous rappeler une vérité essentielle : « Il serait vraiment paradoxal quont continuât en France à se contenter dune perception incomplète, et donc fausse, du passé récent de la Russie, alors que notre pays a offert leur principal refuge aux porteurs de ses valeurs authentiques et que la terre de leurs pères a entamé un processus résolu de retour à ses fondamentaux historiques » (page 11). Louvrage de Nicolas Ross palie ce risque avec sobriété et précision. Le propos de lauteur est autant d'évoquer le destin singulier des soldats blancs que la nature et les fruits, en France notamment, de leur émigration. Il est contient par ailleurs 20 pages de photos, souvent inédites, qui éclairent encore un peu plus le précieux témoignage quil constitue.
F.B.
Nicolas Ross, Aux sources de lémigration russe blanche, Gallipoli, Lemnos, Bizerte (1920-1921), Editions des Syrtes (2011), 185 pages
Carrhes, 9 juin 53 av. J.-C., anatomie dune défaite, de Giusto Traina - La bataille du Teutoburg, 9 apr. J.-C., de Yann Le Bohec - La campagne de Julien en Perse, 363 apr. J.-C. de Catherine Wolff
Les défaites romaines ont été si rares qu'elles ont toujours suscité une fascination particulière de la part des amateurs d'histoire militaire. Trois livres récents nous délivrent, coup sur coup, une analayse édifiante des causes et des conséquences des trois désastres, parmi les plus célèbres, subis par les légions de Rome en Germanie ou en Orient.

Après son livre très original sur « 428, une année ordinaire à la fin de l'empire romain », Giusto Traina reprend la plume aujourdhui, toujours aux Belles Lettres, sur un autre sujet très peu abordé récemment : le désastre subi par Crassus à Carrhes, face aux Parthes de Surena. La démarche suivie par Traina est englobante : l'auteur analyse les événements avec beaucoup recul et dans toute leur complexité, en s'attachant de très près à la personnalité de Crassus, dont il esquisse une sorte de réhabilitation. Il nous explique ainsi les éléments qui ont poussé le triumvir, et les Romains en général, à sous estimer la puissance militaire des Parthes. Le livre ne perd cependant jamais de vue son sujet. Le déroulement de la bataille et la construction du mythe, autour de celle-ci, dans l'historiographie romaine et moderne sont au centre de son récit. On retrouve dans le travail de Traina les composantes qui ont fait le succès de son compatriote Alessandro Barbero à propos de la bataille d'Andrinople : le texte, soutenu par des notes et des références nombreuses, est toujours vivant et épique. Il permet de comprendre que la victoire des Parthes nest pas due à leurs archers à cheval ou à leur cataphractes, mais à un emploi tactique, élaboré et combiné, de ces deux types de cavalerie. Grâce notamment à un parfaite connaissance des lieux, où il s'est rendu, Traina parvient à reconstituer le fil tactique des événements constitutif de la bataille et les illustre de schémas très clairs. De par la rigueur et la profondeur de son propos, « Carrhes, 9 juin 53 av. J.-C., anatomie dune défaite » est sans aucun doute l'ouvrage phare de la rentrée 2011 dans le domaine dans l'histoire militaire antique.

Le livre de Yann Le Bohec sur « La bataille du Teutoburg, 9 apr. J.-C. », publié dans la collection Illustoria, est à la fois plus bref (60 pages) et plus classique. Mais c'est justement sont petit format qui en fait un livre très intéressant, au ton particulièrement incisif et direct, voire même parfois provocateur. L'auteur s'attache tout d'abord à cerner les forces et les chefs en présence : « Les Germains étaient donc beaucoup moins efficace à la guerre que les Romains, mais ils provoquaient l'effroi, pour des motifs souvent irrationnels » (page 22). La localisation désormais quasi certaine du champ de bataille occupe plusieurs pages du livre. Les combats sont ensuite racontés de façon assez rapide, à partir des quelques sources disponibles. Contrairement à l'ouvrage de Traina à propos de Crassus, pas question pour Le Bohec qu'une quelconque complaisance envers l'attitude de Varus : « Il est à la mode de réhabiliter des personnages historiques qui ne le méritent pas toujours. Au total on peut reprocher à Varus sa sévérité, sa rapacité et sa naïveté » (page 34). Par ailleurs, le livret de cartes et de documents fourni est très complet, au regard de la taille réduite du livre.
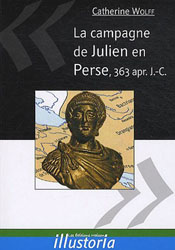
Retour aux affaires d'Orient avec « La campagne de Julien en Perse, 363 après J.-C », de Catherine Schmitt, publié lui aussi dans la collection Illustoria. L'auteur, après un rapide portrait psychologique de l'empereur Julien, consacre le cur de son ouvrage à reconstituer, jour après jour, le fil des événements qui ont émaillé la campagne offensive puis la retraite de l'armée romaine au cur de la Perse des Sassanides. Les cartes, fournies dans le cahier central d'illustrations sont très explicites et permettent de suivre précisément l'itinéraire des soldats romains, en fonction de différentes hypothèses envisageables. Le récit des combats ou des sièges est quand à lui traité de manière plus académique, sur la base des sources habituelles. Le livre de Catherine Schmitt met par ailleurs en évidence l'importance de l'empereur Julien dans le déroulement de la campagne. Son habileté en tant que général, qui peut surprendre au regard de sa formation de philosophe, est bien réelle. Mais l'empereur a aussi des défauts, notamment une certaine agitation, plus ou moins bien maîtrisée, et une volonté d'égaler Alexandre, pour marquer les esprits et permettre de faire avancer ainsi plus efficacement ses projets religieux, qui le poussent parfois à l'erreur. C'est enfin la mort de Julien - l'auteur pense qu'elle est bien l'uvre d'un soldat perse - qui transforme la retraite de l'armée en déroute diplomatique.
F.B.
Giusto Traina, Carrhes, 9 juin 53 av. J.-C., anatomie dune défaite, Belles Lettres (2011), 258 pages
Yann Le Bohec, La bataille du Teutoburg, 9 apr. J.-C., Editions Maison (2008), 92 pages
Catherine Wolff, La campagne de Julien en Perse, 363 apr. J.-C., Lemme Edit (2010), 101 pages
Grammaire des civilisations, de Fernand Braudel - Le choc des civilisations, de Samuel Huntington
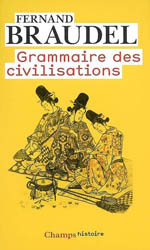
Le livre de Braudel, écrit en 1963 (avec une série de post-scriptum en 1966), a été publié pour la première fois sous le titre de « Grammaire des civilisations » en 1987. Au départ il s'agit d'un projet de manuel pour les classes de Terminale qui, jugé trop ambitieux, ne sera jamais approuvé comme tel. Par grammaire, on entend l'ensemble des règles qui régissent et organisent une langue, tout en lui conférant sa singularité. Braudel s'applique donc à comprendre les règles et les singularités de chacune des grandes civilisations historiques, en partant d'une analyse du mot en lui-même : « civilisation » avec ou sans s est une invention française tardive du XVIIIème siècle. Pour ce qui est du fond, Braudel pose ensuite la définition suivante : « Une civilisation, ce n'est donc ni une économie donnée ni une société donnée, mais ce qui, à travers des séries d'économies, des séries de sociétés, persiste à vivre en ne se laissant qu'à peine et peu à peu infléchir » (page 82). Selon lui, la compréhension des religions est sans doute le point le plus important, pour étudier et comprendre les civilisations : « La religion est le trait le plus fort, au cur des civilisations, à la fois leur passé et leur présent. Et tout d'abord, bien entendu, au cur des civilisations non européennes. (...) Le christianisme s'affirme une réalité essentielle de la vie occidentale et qui marque, sans qu'il le sachent ou le reconnaissent toujours, les athées eux-mêmes. Les règles éthiques, les attitudes devant la vie et la mort, la conception du travail, la valeur de l'effort, le rôle de la femme ou de l'enfant, autant de comportements qui ne semblent plus rien avoir avec le sentiment chrétien et cependant en dérive. Il n'en reste pas moins que la tendance de la civilisation occidentale, dès que se développe la pensée grecque, c'est sa poussée vers le rationalisme, donc vers un dégagement par rapport à la vie religieuse. Mais c'est sa singularité » (pages 66 et 67).
La première civilisation évoquée est celle de l'Islam. Braudel constate qu'elle a «manqué d'hommes » au moment de son âge d'or et a ensuite dû supporter le fardeau de « trop d'hommes » lors de son déclin, phénomène qui perdure encore aujourd'hui. Il évoque également les grand penseurs de l'Islam et de leurs travaux philosophiques : « Oui cette philosophie est une : désespérément enfermée entre la pensée grecque d'un côté et la révélation coranique de l'autre, elle se heurte à ces murs et reflue sans cesse, vers son point de départ » (page 139 et 140). Braudel date le déclin de l'Islam par la mort d'Averroès. Il explique aussi le rôle dans celui-ci d'Al-Gazali, une sorte d'anti philosophe, défenseur tardif de la religion traditionnelle. L'explication la plus marquante donnée par Braudel sur les phases d'expansion et de repli de la civilisation musulmane est liée à la mer. Pour lui le déclin définitif de l'islam découle de la perte de contrôle de la Méditerranée, à partir de la fin du XIème siècle, malgré retour de flamme à l'époque Ottomane, au XVème et XVIème siècle, à laquelle Lépante mettra fin. Dans l'océan indien avec l'arrivée des Portugais au XVème siècle est décisive. Ils prennent en effet rapidement l'ascendant sur les navigateurs musulmans. Le point ultime de ce repli réside dans le fait que les « marines musulmanes » manqueront la révolution de la vapeur, tout comme leur civilisation manquera plus globalement la révolution industrielle.
Braudel étudie ensuite le « Continent noir » en évoquant d'entrée les contingences géographiques de l'Afrique : enclavement entre un désert au nord et au sud et entre un océan à l'ouest et à l'est. La question de l'esclavage est bien entendu présente : « Il y a toujours eu, à la décharge de l'Europe, des réactions de piété et d'indignation vis-à-vis de l'esclavage des Noirs. Elles n'étaient pas purement formelles puisqu'elles ont abouti tout de même, un beau jour, au mouvement de Wilberforce en Angleterre, pour la libération des Noirs et l'abolition de l'esclavage. Sans affirmer qu'une des traites négrières (vers l'Amérique) a été plus humaine, ou moins inhumaine que l'autre (vers l'Islam), on notera ce fait, important pour le monde noir actuel, qu'il y a aujourd'hui des Afrique vivante dans le Nouveau Monde. De fort noyaux ethniques se sont développés et perpétués jusqu'à nos jours, au nord et au sud de l'Amérique, tandis qu'aucune de ces Afrique exilées n'a survécu en Asie ou en terre d'Islam » (page 204). C'est dans ce chapitre qu'apparaît la formule « choc des civilisations » pour la première fois (de l'histoire des idées semblent-il également). Braudel explique que les « chocs des civilisations », des simples contacts commerciaux au cas extrême de la colonisation, génèrent toujours un passif ET un actif.
Le chapitre suivant est consacré à l'Extrême Orient dans lequel Braudel rassemble Chine, Inde, Japon et civilisation du sud-est asiatique, tout en y consacrant ensuite des sous-chapitres distincts. Il voit dans ces grandes civilisations des « mondes végétaux », marqués par l'immobilisme sur la très longue durée et par le mode d'alimentation à dominante végétarienne de leurs populations, très tôt devenues (trop) nombreuses. Ces mondes sont aussi marqués par la menace permanente des nomades : Mongols ou Turkmènes. Pour la Chine et l'Inde, ses analyses et réflexions sur les systèmes religieux des locaux sont lumineuses et envoutantes.
Le dernier chapitre de « Grammaire des civilisations » est consacré à la civilisation européenne. Braudel y insiste de manière importante sur l'importance des Croisades dans la formation de l'idée européenne. Pas pour leur côté religieux, mais pour celui d'une « première expérience commune » pour les Européens. Le bénéfice des croisades est surtout de la reconquête de manière durable et décisive de la Méditerranée de manière durable (son sujet de prédilection). Dans un deuxième temps, Braudel parle d'une autre particularité de la civilisation européenne : le goût immodéré pour le concept de « liberté », avec dans l'ordre, les libertés (individuelles, particulières, citadines, privilèges), LA liberté, puis le libéralisme. Vient ensuite la partie sur la Chrétienté que Braudel caractérise comme « se sauvant dans un monde en péril, mais au prix de mille prouesses » et conclut qu'en « dehors de cette hostilité d'adversaires appuyés sur des idéologies réfléchies, l'Eglise a dû faire face constamment à cette déchristianisation régulière, monotone qui n'est souvent que vulgaire décivilisation » (page 455). Il évoque ensuite le penchant rationaliste, caractéristique lui aussi de l'Europe issue qui se fraye son chemin dans à travers de tous les courants de pensée, chrétien, humaniste et naturellement philosophiques et scientifiques. Le point clé reste néanmoins la « révolution industrielle » si spécifique à la civilisation européenne et à la position dominante qu'elle lui permet d'acquérir. Braudel évoque également les autres Europe : l'Amérique latine, les Etats-Unis (avec beaucoup des détails), les mondes anglo-saxons et l'Europe russe et orthodoxe devenue soviétique. C'est d'ailleurs sur le communisme que son texte apparaît aujourd'hui comme le plus « daté », car il n'anticipe pas l'issue soudaine de la Guerre Froide dans les années 1990. Son analyse et ses conclusions sur l'idée d'Union européenne et de ses problèmes en devenir par contre réellement prophétique.
Par sa clarté, par son style merveilleux et par la profondeur de ses réflexions la « Grammaire des civilisations » est plus qu'un classique, il s'agit d'une uvre majeure - et si intelligente pour comprendre notre monde.

Le livre de Samuel Huntington, publié en 1997, trouve dans la « Grammaire des Civilisations » pas mal de son « carburant » et reprend le fil de la réflexion là où Braudel s'était arrêté. On a récemment tellement parlé de ce livre que l'on a sans doute finit par oublier de le lire. Écrit il y a 14 ans déjà, « Le choc des civilisations » est un texte capital pour comprendre le début du XXIème siècle, car il a profondément influé - c'est indéniable - la nature des relations internationales depuis la fin de la guerre froide, tant par l'adhésion parfois caricaturale qu'il a généré chez certains ou le rejet parfois lui aussi teinté d'incompréhension qu'il a provoqué ailleurs. Quoi que l'on en pense (du bien ou du mal), le livre d'Huntington est un ouvrage important pour appréhender notre monde.
On notera par exemple (page 18) : « Les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique mais pas universelle et s'unir pour lui redonner vigueur contre les défis posés par les sociétés non occidentales. Nous éviterons une guerre généralisée entre civilisations si, dans le monde entier, les chefs politiques admettent que la politique globale est devenue multi-civilisationelle et coopèrent à préserver cet état de fait ». Ou encore page 61, sur l'apogée de l'Occident : « L'Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient les supérieures (rares ont été les membres d'autres civilisations à se convertir) mais plutôt par sa supériorité à organiser la violence organisée. Les Occidentaux l'oublient souvent, mais les non-Occidentaux jamais. En 1910 le monde était bien plus unifié politiquement et économiquement qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire de l'Humanité ».
Le chapitre sur les langues est original, notamment en réfutant les arguments habituels faisant de l'anglais une langue mondiale : « En ce sens l'anglais est le mode de communication interculturel mondial, comme le calendrier chrétien est le mode mondial de découpage du temps, les chiffres arabes le mode mondial de numérotation et le système métrique, en grande partie, le mode mondial de mesure. Cependant on utilise l'anglais comme mode de communication interculturel. Le présuppose donc des cultures distinctes. C'est un outil de communication, pas un vecteur d'identité, ni un lien communautaire. Le fait qu'un banquier japonais et un homme d'affaire indonésien se parlent en anglais n'implique pas qu'ils soient anglicisés ou occidentalisés. De même pour les Suisses germanophones et francophones : ils communiquent entre eux aussi bien en anglais que dans l'une ou l'autre de leurs langues nationales » (page 77). Sur les religions (page 141) : «En ce sens, le renouveau des religions non-occidentales est la manifestation la plus puissante de l'anti occidentalisme dans les sociétés non occidentales. Ce renouveau n'est pas un rejet de la modernité ; c'est un rejet de l'Occident et de la culture laïque, relativiste, dégénérée qui est associée à l'Occident (...) C'est une déclaration d'indépendance culturelle vis à vis de l'Occident, une affirmation fière : nous serons modernes, mais nous ne serons pas vous ! ».
En en guise de conclusion (page 480), Huntington affirme que « le multiculturalisme menace de l'intérieur les États-Unis et l'Occident ; l'universalisme menace l'Occident et le monde. Ces deux tendances nient chacune le caractère unique de la culture occidentale. Les mono culturalistes veulent que le monde soit comme l'Amérique. Les multi culturalistes veulent que l'Amérique soit comme le monde. Une Amérique multiculturelle est impossible parce qu'une Amérique non occidentale ne peut-être américaine. Un mode multiculturel est inévitable parce qu'un empire mondial est impossible. La sauvegarde des États-Unis et de l'Occident doit passer par le renouveau de l'identité occidentale. La sécurité du monde ne se conçoit pas sans l'acceptation de la pluralité des cultures ». Au bout du compte, « Le choc des civilisations », est un livre passionnant et qui pose les bonnes questions. Il a malheureusement été autant dénaturé dans ses transpositions politiques par ses détracteurs que par ses partisans.
F.B.
Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, Flammarion (2008), 752 pages
Samuel Huntington, Le choc des civilisations, Odile Jacob (2009), 545 pages
Camille ou le destin de Rome : 406-390 av. J.-C., de Thierry Piel et Bernard Mineo

La chute de Véies en -396, après dix années de siège, puis la mise à sac de Rome par les Gaulois Sénons, en -390 constitue deux événements capitaux dans la construction de l'histoire de Rome par les Romains eux-mêmes. Les deux auteurs s'attachent dans un premiers temps à analyser toutes les sources disponibles afin de dégager, autant que faire se peut, le déroulement strictement historique des faits : la rivalité entre Rome et la cité étrusque de Véies à propos de la cité de Fidènes, le rôle politique et militaire de Marcus Furius Camillus, l'irruption des Sénons dans le Latium, la défaite romaine de l'Allia, l'incendie et le sac de Rome par les Gaulois (à l'exception du Capitole), le rôle complexe de peuples rivaux (Falisques ou Capénates) ou de cités amies (comme Caere). Dans un second temps, les auteurs analysent la manière dont les Romains, dans leur littérature postérieure aux événements, ont élaboré un récit symbolique, quasi mythologique, de leur « haute histoire ». Camille devient pour Tite Live un second Romulus, un modèle qui inspire le princeps Auguste, lui-même restaurateur de l'état après les troubles des Guerres Civiles. L'ensemble des événements vécus par Rome entre 406 et 390 av. J.-C sont ainsi réinterprété par les auteurs romains dans leur quête d'offrir à la Ville une histoire de ses origines susceptible d'impressionner des voisins, souvent plus raffinés (Carthage, Orient Hellénistique). La prise de Véies devient ainsi une sorte de Guerre de Troie fondatrice pour les Romains. Dans un registre un peu différent, le fait que la conquête décisive de Véies soit suivie d'aussi près par le terrible revers que Brennus à fait subir à Rome, au point de risquer de la faire disparaître de l'Histoire, a influencé la République romaine devenue plus tard conquérante universelle : est-il possible d'abattre Carthage, comme le fut Véies, sans risquer en ensuite la destruction de Rome ? Très complet sur son sujet, très bien présenté avec ses diverses annexes (chronologie, lexique, cahier d'illustrations), le livre de Thierry Piel et Bernard Mineo est tout à fait passionnant, car il se savoure comme une (double) enquête policière, sur les faits et leurs multiples réinterprétations.
F.B.
Thierry Piel et Bernard Mineo, Camille ou le destin de Rome : 406-390 av. J.-C., Lemme Edit (2010), 100 pages
Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée

L'ouvrage est la réédition du journal de baron Percy, chirurgien major de la Grande Armée, paru pour la première fois en 1904. Percy, né en Haute-Saône en 1754 est le prototype même de « l'honnête homme » au service des autres, ambitieux uniquement par compétence et sens du devoir. Son journal est particulièrement empreint de hauteur de vue nous fait suivre l'armée française en Allemagne et en Suisse (1799-1800), en Bohème (1805), en Pologne (1806-1807) et en Espagne (1808-1809). Les récits d'opérations et de soins sont parfois difficile à lire dans leur dureté et leur précision « chirurgicale », mais ils permettent de se faire une idée très claire des souffrances des blessés (et des malades) au cours des guerres napoléoniennes. Percy donne également ses impressions de voyageur dans les pays qu'il traverse. C'est de la Pologne, avec plaines sablonneuses et ses forêts de bouleaux, dont il donne l'image la plus saisissante et la plus étonnante pour un lecteur d'aujourd'hui. On peut également lire ses projets pour mettre en place un véritable service de « chirurgie de bataille », précurseur à sa manière de l'idée qui présidera 50 années plus tard à la création de la Croix Rouge. Au final, on retiendra le caractère très instructif de son récit, tant à propos de son activité de chirurgien que pour ses descriptions du quotidien de la Grande Armée, ou encore pour l'évocation de ses rencontres avec les anonymes, hébergeant dans toute l'Europe les officiers en campagne, et avec les grands souverains de l'époque (l'Empereur Napoléon, le Tsar Alexandre ou le roi de Prusse).
F.B.
Pierre-François Percy, Journal des campagnes du baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée, Tallandier (2002), 537 pages
Identités romaines, conscience de soi et représentation de l'autre dans la Rome antique, textes édités par Mathilde Simon
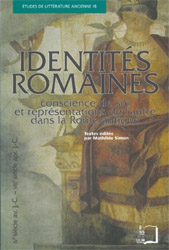
Cet ouvrage collectif propose, en quinze articles, d'éclairer des lecteurs, déjà bien versés dans les études antiques, sur la notion d'identité ethnique et culturelle à Rome. Au cours de sa longue histoire, la Ville puis l'Empire ont vu se construire des identités romaines (le pluriel est important), dans la continuité de lhellénisme et en opposition aux « barbares » : comment les Romains se voyaient-ils et comment voyaient-ils les autres ?
Dans sa quête du concept didentité romaine, louvrage, dirigé par Mathilde Simon, souvre naturellement, dans sa première partie, sur lappropriation progressive de la culture grecque par le monde latin. Ce mécanisme passe par lart comme par la langue. Le premier article sattache à décoder limportance de lutilisation des codes iconographiques grecs pour pouvoir montrer son appartenance à une sphère culturelle brillante. Le second, sappuie sur luvre du poète Horace qui développe de façon savante et ludique une poétique où latin et grec déploient leur capacité de réverbération. La romanité saffirme aussi et progressivement par elle même, comme le démontre deux autres articles consacrés aux plaidoyers du jeune avocat Cicéron et aux uvres de Tite-Live : « au relâchement et au manque de contrôle manifestés par certains sopposent la temperentia et la continentia romaine : le Romain sait se tenir » (page 68). Lidentité romaine sédifie également grâce aux menaces qui pèsent sur son existence. Cicéron évoque ces périls en parlant de « monstres », dennemis absolus, capables de détruire la civilisation, comme Pyrrhus ou Hannibal, pour mettre en valeur lesprit dhumanitas dont savent faire preuve les Romains en toutes circonstances. Préserver la patrie devient ainsi le plus important des devoirs et conditionne les relations de Rome avec ses adversaires. Ces concepts sont également évoqués dans trois autres articles, à travers luvre de Juvénal, la poésie tardive (y compris celles des premiers chrétiens) et dans la comparaison des textes de trois auteurs classiques que sont Verrius Flaccus, Pompeius Festus et Paul Diacre. La seconde partie de louvrage aborde la question de lidentité de lAutre. On y découvre la construction d'une image du Parthe, contre qui Rome, en digne héritière des Grecs, sefforce de reprendre le combat. On y aborde aussi limage de lEspagne, via les textes dun de ses « fils », le poète Martial. Larticle sur limage des Lusitaniens chez Tite-Live est sans doute encore plus évocateur. Il expose la subtilité de lhistorien padouan qui donne une image originale de ce peuple « en faisant passer au second plan le thème du brigandage et en mettant davantage laccent sur le caractère redoutable de ces guerriers ainsi que lintroduction déléments inédits sur une capacité dorganisation dont ils font preuve avant même que des chefs charismatiques, comme Viriathe ou plus tard Sertorius, ne prennent leur tête » (page 176). Sil le fait, cest aussi pour rehausser la gloire des Romains qui auront mis tant de temps à vaincre les Lusitaniens. Après avoir abordé le cas du monde grec à Rome (acculturation du culte dionysiaque) et analysé limage trouble de la Grande Grèce (Italie du sud) à lépoque dAuguste, le livre se conclut sur les identités romaines loin de Rome. On y découvre les particularismes du quartier italien de Délos et on y entend le « Quid melius Roma ? » d'un Ovide nostalgique, idéalisant depuis son exil la Ville qui lui manque tant. Ouvrage de spécialistes destinés à des lecteurs en passe de le devenir, Identités romaines déploie néanmoins une érudition qui demeure accessible (toutes les citations latines sont traduites et expliquées) et qui reste finalement très agréable à côtoyer.
F.B.
Mathilde Simon (collectif, sous la direction de), Identités romaines, conscience de soi et représentation de l'autre dans la Rome antique (IVe siècle avant J.-C. - VIIIe siècle après J.-C.), Rue d'Ulm (2011), 287 pages
La guerre de Sécession, de John Keegan

Keegan nous offre avec cet ouvrage une excellente synthèse sur la Guerre de Sécession. Son style vif et le plan de son ouvrage, qui n'oublie aucun des aspects de cette guerre fondatrice, rendent la lecture très agréable. Keegan règle aussi son compte à la « cause perdue » (page 460) : « Savoir si le Sud aurait pu remporter la guerre est devenue l'une des questions les plus débattues après le conflit. La réponse est non ». Il dresse des portraits tout en psychologie des plus grand généraux de la guerre, Grant et Sherman, comme de ceux qui ont démontré une grande mais incomplète valeur - Jackson, Lee, Sheridan ou Forrest - sans oublié les pire, comme McClellan. Dans sa conclusion, il oppose de manière très originale Lincoln à Marx sur les leçons à tirer du conflit et il indique l'ouvrier américain « ne désirait pas former des armées industrielles, ayant déjà, comme des centaines de milliers de ses semblables, appartenu à de véritables armées, servi et appris par l'expérience qu'elles n'apportaient que souffrances. Une seule expérience de l'armée suffisait à un individu comme à une nation. Le socialisme américain mourut dès sa naissance sur les champs de bataille de Shiloh et de Gettysburg ».
F.B.
John Keegan, La guerre de Sécession, Perrin (2011), 504 Pages
Les métamorphoses de la cité, de Pierre Manent

Les métamorphoses de la cité, essai de Pierre Manent sur la « dynamique occidentale » m'a ravi et passionné. Le propos du livre est d'apporter une explication au « projet de modernité » propre à l'Occident, qui le distingue des autres civilisations, toutes aussi respectables, mais qui n'ont pas bâtie leur histoire sur ces mêmes bases. Pour Manent, le point de départ nous vient de la Grèce classique : « La cité grecque fut la première forme de la vie humaine à produire de l'énergie politique, c'est-à-dire à déployer de l'énergie humaine d'une intensité et d'une qualité inédite. Elle fut finalement consumée par sa propre énergie dans la catastrophe de la Guerre du Péloponnèse ». Manent explique ensuite comment les évolutions de l'Occident n'ont pas fait s'éteindre le feu de cette quête de modernité : « La forme qui succéda à la cité ce fut l'Empire. L'empire occidental, à la différence de l'empire oriental, est une certaine continuation de la cité : la cité de Rome déploya des énergies si puissantes, qu'elle rompit toutes les limites qui circonscrivaient les cités, qu'elle s'adjoignit des populations toujours plus nombreuses et lointaines jusqu'à paraître sur le point de rassembler le genre humain tout entier. L'Empire occidental renonce à la liberté de la cité mais promet l'unité et la paix ». Une fois encore, l'échec relatif du mode impérial n'est que temporaire : « L'idée impériale va marquer l'Occident non seulement par le prestige durable de l'Empire romain, mais sous une forme absolument inédite, elle aussi propre à l'Europe, à savoir l'Eglise, l'Eglise catholique, c'est-à-dire universelle, qui entend réunir tous les hommes dans une communion nouvelle, plus étroite que la cité la plus close, plus étendue que l'Empire le plus vaste. De toutes les formes politiques de l'Occident, l'Eglise est la plus chargée de promesses puisqu'elle propose, je viens de le dire, une communauté qui est à la fois cité et empire, mais aussi la plus décevante parce qu'elle ne parvient jamais, loin s'en faut, à rendre effective cette association universelle dont elle a éveillé le désir ». Selon Manent, la « situation chrétienne » marquée par la concurrence des autorités, nécessite, d'un point de vue politique une réconciliation entre paroles et actes. La solution a été trouvée dans l'état neutre, agnostique et représentatif que nous connaissons: « Voilà donc comment a été résolu le problème des temps chrétiens, le problème de l'anarchie des autorités de la disjonction et de l'écart excessif entre les paroles et els actions. Il a été résolu par l'Etat souverain et le gouvernement représentatif de la société. C'est notre régime politique considéré dans son tout qui est la solution du problème : le facteur décisif de la jonction, de la réconciliation entre les actions et les paroles, c'est la formation d'une parole commune par l'élaboration, le perfectionnement et la diffusion d'une langue nationale ».
Le développement de l'ouvrage (plus de 700 pages) s'effectue d'abord au travers d'une analyse de l'expérience originelle de la cité grecque (à travers d'Homère, d'Aristote, de Platon et la réinterprétation du phénomène par Machiavel et Montesquieu ou Hobbes). Il se poursuit par une enquête sur l'énigme de Rome (ses rapports à la Grèce, sa vision par les modernes). Dans cette seconde partie, c'est sur Cicéron que Manent appuie son travail. Manent pointe aussi le rôle singulier et spécifique de César dans les mutations du modèle Occidental, avec l'invention, car c'en est une, du césarisme : « Normalement, selon l'ordre usuel des choses, la république succède à la royauté ; ce fut le cas en Grèce et à Rome ; ce fut aussi le cas dans la plupart des pays d'Europe, à commencer par la France. Eh bien, le césarisme, en France comme à Rome - mais la Grèce ignore ce phénomène - c'est cette monarchie qui succède à une république qui avait succédé à une royauté. Une nouvelle séquence historique est ajoutée, absente de l'expérience grecque ».
Enfin, la dernière partie porte sur l'Empire, l'Eglise et la Nation, notamment à partir de l'ouvrage majeur de Saint Augustin qu'est « La cité de Dieu », en le mettant en perspective avec la question de la grandeur de Rome et le rejet du modèle personnifié par Caton. Manent s'appuie cette fois encore sur Machiavel, Rousseau et Hobbes pour commenter Saint Augustin. Manent explique finalement comment depuis le XVIe siècle le Christianisme a été, dans son rôle de « médiateur de la société, d'abord « nationalisé » par la Réforme, avant d'être « neutralisé » dans les états nationaux laïques. Le christianisme national, puis la Nation tout court ont ainsi le relais de l'Eglise en Europe.
Les métamorphoses de la cité est un ouvrage riche et complexe qui retrace avec une acuité vivifiante l'histoire politique de l'Occident. Sa lecture requiert une grande concentration et se révèle parfois complexe, mais l'effort est récompensé par la l'intérêt des thèses développées. On sent à chaque page l'amour de l'auteur pour la cité et son évolution, pour la richesse de l'héritage politique singulier de l'Occident. On en perçoit grâce à une argumentation toujours très solide, la vraie valeur. La conclusion de Pierre Manent amène finalement à réfléchir sur l'avenir politique de nos sociétés occidentales : « Aujourd'hui l'humanité est bien considérée par l'opinion commune européenne comme la seule ressource et référence disponible après l'épuisement des nations. Mais cette humanité, je viens de le relever, est dépourvue de portée politique, elle ne constitue pas une ressource politique effective. Elle est toute au plus le cadre de référence d'un sentiment du semblable sur lequel il est impossible d'appuyer aucune construction politique. Il s'agit d'une humanité immédiate, englobant indifféremment « tous les hommes » et « tout homme », qui n'offre aucune ressource pour la médiation. Aujourd'hui, parmi les Européens, l'humanité est une référence immédiatement opposable à toute entreprise, à toute action politique effective. Alors que l'humanité qui mit en mouvement les hommes de 1789 était inspiratrice et capable d'alimenter les plus vastes ambitions, l'humanité au nom de la quelle on édicte aujourd'hui la règle ne sait que protéger ce qui est et interdit ce qui pourrait être ».
F.B.
Pierre Manent, Les métamorphoses de la cité : essai sur la dynamique de l'Occident, Flammarion (2010), 424 pages
Henri III, de Pierre Chevallier
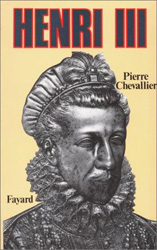
Voir aussi, toujours sur Henri III : Dans Trois couronnes pour un roi, Nuccio Ordine démêle les fils d'une enquête érudite et passionnante sur la signification de la devise d'Henri III - « Manet ultima coelo » - reprise à sa suite par Henri IV et également paraphrasée par la devise - « Aliamque moratur » - de Marie Stuart. L'ultime couronne, en marge de celle de France et de Pologne, est-elle ou Ciel, ou plus prosaïquement en Angleterre ? Utilisant les textes des témoins de la période, notamment Giordano Bruno, l'auteur nous apprend énormément de choses sur l'époque du dernier des Valois et sur la symbolique des motto, alors particulièrement en vogue. F.B. Pierre Chevallier, Henri III, roi shakespearien, Fayard (1985), 751 pages Le livre de Patrice Brun porte autant sur la bataille de Marathon, dans les faits, que sur l'aura que cette bataille a recueilli à travers les siècles.
Le point de départ repose sur les liens entre Histoire et Mythe dans la mentalité des Grecs anciens. Brun cite Démosthène (page 19) : « Ces actions qui, pour le mérite, ne le cèdent en rien aux exploits élevés au rang des mythes mais qui, plus proches de nous dans le temps, n'ont pas encore été transformées en mythes ni élevées à la dignité héroïque ». Et Brun de conclure : Pour les Grecs, le temps était un tamis dont il ne demeurait que les exploits dignes d'être rapportés. L'auteur analyse le déroulement de la bataille avec précision, s'attachant surtout aux causes et aux conséquences de ce qui allait devenir un des événements fondateur de l'histoire athénienne et du monde grec en général. Quel était le but des Perses ? Remettre Hippias en place ? En tout cas les Athéniens ne semblent pas s'être préoccupé de cette question, réagissant simplement avec célérité à un débarquement surprenant sur leur territoire sacré (pages 35 et 36) : « La part de sacrilège que pouvait représenter une invasion étrangère était donc importante et cela d'autant plus dans une cité comme Athènes où le mythe fondateur de la cité était l'autochtonie : ce qui, au sens étymologique du terme, signifiait que les Athéniens se considéraient comme nés de la terre elle-même, cette terre qu'il n'était évidemment pas question de laisser souiller impunément par un ennemi barbare de surcroît ». Brun nous offre également une très bonne étude sur le personnage de Philippidès, l'hémérodrome (littéralement « celui qui peut courir toute une journée ») qui a parcouru les 240 km menant à Sparte en 36 heures pour aller chercher des renforts. L'auteur ne remet d'ailleurs pas en cause cette performance, tout à fait plausible pour un messager « professionnel ». La thèse centrale sur la bataille est abordée dans le chapitre intitulé « Le sens de la victoire » et développe l'idée que Marathon est une sorte de Valmy du nouveau régime démocratique qui vient tout juste d'être établi à Athènes. Encore une fois le livre permet avant tout de remettre événements et interprétation en perspective (page 135) : « Les Grecs n'étaient pas des dévots stupides et savaient bien que l'ardeur guerrière, la discipline militaire avaient été indispensables au triomphe. Mais ils n'étaient pas moins persuadés de l'aide divine, qui leur avait insufflé ces qualités et le courage nécessaire pour affronter un ennemi jusqu'à là invincible. Encore une fois, on peut se moquer de cette apparente crédulité ; la posture est aisée, qui fait passer son auteur pour un esprit fort. Mais on prend alors le risque de ne pas comprendre l'âme grecque, chose bien gênante quand on écrit l'histoire ». L'ouvrage est très bien écrit, dans un style fluide et précis, jamais dénué d'humour et agrémenté de propos parfois acerbes mais toujours à propos. Il s'agit donc d'un livre précieux et rare, d'autant plus que l'histoire militaire est désormais souvent l'apanage des auteurs anglo-saxons. F.B. Patrice Brun, La bataille de Marathon, Larousse (2009, 223 pages Edward Luttwak publie aujourd'hui La Grande Stratégie de l'Empire Byzantin exactement après son chef d'uvre intitulé La Grande Stratégie de l'Empire Romain.
Le résultat est tout aussi probant et réussi. Le livre est écrit dans un style brillant : Luttwak est à la fois plaisant et fascinant à lire, car on sent derrière chaque ligne l'ampleur du travail sous-jacent. Le livre s'ouvre sur l'analyse du contexte : « Les ennemis de l'Empire était capable de vaincre ses armées et ses flottes lors de batailles, mais ne parvenaient pas à vaincre sa grande stratégie. C'est ce qui permit à l'Empire de résister aussi longtemps ; sa plus grande force, immatérielle, restait hors de portée des attaques directes de ses ennemis » (page 27). Luttwak pointe notamment l'importance de la menace qu'Attila et les Huns ont fait peser sur l'Empire dans la mise en place d'une grande stratégie originale. Le livre analyse ensuite les moyens et les méthodes mis en uvre par Byzance : politique de prestige, diplomatie et recherche d'alliances, mariages dynastiques, géographie de la puissance, moyens spécifiques déployés contre les Bulgares, les Arabes et les Turcs. Cette seconde partie est la plus intéressante.
La suite évoque les différents traités ou essais byzantins sur l'art de la guerre et la diplomatie, dans une partie plus théorique. On y découvre également que « Conserver des ordres en latin au sein d'une armée parlant le grec ne relevait pas d'un conservatisme gratuit, c'était une façon de maintenir la continuité avec ce qui était alors - et reste de nos jours - l'institution militaire ayant connu les succès les plus durables dans toute l'histoire de l'humanité, l'héritage le plus important que l'Empire de la nouvelle Rome reçut de l'ancienne » (page 289). Enfin la conclusion met bien en valeur les particularités d'un monde qui a survécu mille ans à de multiples menaces et dont nous pouvons encore aujourd'hui tirer un grand nombre de leçons : « L'élite gouvernante des Byzantins regardait le monde extérieur et ses dangers sans fin avec un avantage stratégique qui n'était ni d'ordre diplomatique ni d'ordre militaire, mais plutôt d'ordre psychologique : la puissante capacité morale de confiance et d'espoir, si rassurante, que leur donnait leur triple identité. Cette identité était plus intensément chrétienne que ne peuvent aisément l'imaginer la plupart des esprits modernes, et plus précisément chalcédonienne par sa doctrine ; elle était également hellénique par sa culture, heureuse propriétaire du païen Homère, de l'agnostique Thucydide comme des poètes irrévérencieux - bien que le terme Hellène fut un mot longtemps évité, car il signifiait « païen » ; elle était aussi fièrement romaine, non sans justification car les institutions romaines durèrent longtemps, au moins symboliquement » (page 434). La Grande Stratégie de l'Empire Byzantin est plus qu'un livre indispensable sur la période, c'est un véritable joyau dont la lecture permet de comprendre tout un univers historique. F.B. Edward Luttwak, La Grande Stratégie de l'Empire Byzantin, Odile Jacob (2010), 512 pages
Nuccio Ordine, Trois couronnes pour un roi : la devise d'Henri III et ses mystères, Belles Lettres (2011), 430 pages
La bataille de Marathon, de Patrice Brun
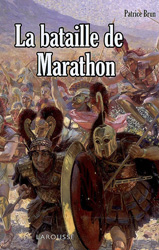
La Grande Stratégie de l'Empire Byzantin, d'Edward Luttwak
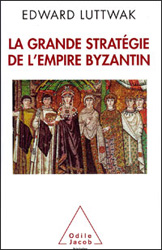
« Cur , mon cur , confondu de peines sans remèdes, reprends-toi. Résiste à tes ennemis : oppose-leur une poitrine contraire. Ne bronche pas au piège des méchants. Vainqueur, n'exulte pas avec éclat ; vaincu, ne gémis pas prostré dans ta maison. Savoure tes succès, plains-toi de tes revers, mais sans excès. Apprends le rythme qui règle la vie des hommes puisque tes propres amis te torturent, mon cur. »
Archiloque